Introduction
Quand on parle de pollinisateurs, beaucoup pensent direct aux abeilles qui butinent tranquillement dans nos jardins. Mais en réalité, il y en a plein d'autres qui bossent dans l'ombre pour préserver notre alimentation et la biodiversité agricole : papillons, chauves-souris, oiseaux et compagnie participent aussi activement à ce boulot discret mais indispensable. Ces petites (et parfois grandes) bestioles assurent la reproduction d'environ 75% des cultures alimentaires mondiales. Rien que ça !
Pourtant, au fil des années, la survie de ces précieuses créatures est devenue sacrément difficile. Entre les pesticides comme les fameux néonicotinoïdes, la disparition progressive de leur habitat naturel et les chamboulements dûs aux changements climatiques, le quotidien des pollinisateurs est désormais un vrai parcours du combattant. Pas étonnant qu'on entende souvent parler aujourd'hui du tristement célèbre « déclin des abeilles ». Et franchement, c'est inquiétant, parce que sans eux, c'est nos assiettes qui deviendraient nettement plus tristes et beaucoup moins variées.
Heureusement, les solutions existent déjà, et on peut tous y mettre notre grain de sel. Protéger les habitats naturels, adopter des pratiques agricoles plus durables et sensibiliser un max de gens à l'importance de ces héros minuscules sont des pistes sérieuses qui marchent vraiment. Et ça, c'est plutôt cool : on n'a pas besoin de réinventer la roue, juste de mettre un petit coup d'accélérateur à des actions concrètes et quotidiennes.
Alors, plongeons-nous ensemble dans le monde passionnant de ces discrets alliés de notre quotidien et voyons comment, de manière simple et efficace, chacun peut contribuer à garantir leur avenir—et par ricochet, le nôtre.
30% des cultures mondiales
Le pourcentage de cultures dans le monde qui dépendent de la pollinisation par des insectes.
80% des plantes à fleurs
Le pourcentage des plantes à fleurs qui ont besoin de la pollinisation pour se reproduire.
35 % des cultures vivrières
La part des cultures vivrières qui dépendent de la pollinisation par les abeilles.
1,4 milliard emplois agricoles
Le nombre d'emplois agricoles dans le monde qui dépendent directement des pollinisateurs.
Le rôle des pollinisateurs dans l'agriculture
Les principaux pollinisateurs
Abeilles domestiques et sauvages
Les abeilles domestiques (Apis mellifera) sont surtout connues pour le miel, mais elles assurent aussi un boulot de dingue côté pollinisation. Une seule ruche peut polliniser jusqu'à 300 millions de fleurs par jour. Concrètement, le fait d'installer une ou plusieurs ruches près d'une exploitation agricole peut booster les rendements de certains fruits et légumes, comme les pommes, les amandes ou les courgettes, jusqu’à 30 à 40 %.
Les abeilles sauvages, comme les osmies ou les bourdons, ne produisent pas de miel, mais elles ont des atouts uniques : elles volent souvent par temps couvert ou venteux, quand les domestiques préfèrent rester au chaud. Résultat, elles assurent une pollinisation complémentaire hyper utile. Petite action simple pour aider ces ouvrières méconnues : laisser traîner des morceaux de bois avec des petits trous ou installer des hôtels à abeilles, histoire de leur fournir un habitat facile et sécurisé. Ça marche particulièrement bien pour l'osmie cornue (Osmia cornuta), une abeille solitaire super efficace sur les arbres fruitiers.
Autre astuce concrète : semer des plantes nectarifères locales dans son jardin ou ses champs attire les abeilles sauvages qui sont souvent très spécialisées dans leurs choix alimentaires. La vipérine, par exemple, est un vrai buffet pour plusieurs espèces. Plus on diversifie les fleurs sauvages locales, plus on multiplie les pollinisateurs qui débarquent pour bosser—et mieux la biodiversité agricole locale se porte.
Papillons et mites
Quand tu penses pollinisateurs, tu imagines sûrement les abeilles, mais il ne faut pas oublier que papillons et mites assurent aussi une sacrée partie du boulot. Ils visitent souvent des fleurs différentes ou moins accessibles que celles préférées par les abeilles, grâce à leurs langues très longues capables d'atteindre profondément le nectar. Par exemple, le fameux moro-sphinx (aussi appelé sphinx-colibri) est une mite incroyable qui pollinise efficacement certaines fleurs tubulaires, comme la valériane.
La diversité des papillons dans ton jardin indique une bonne santé écologique générale. Donc, pour attirer davantage de papillons chez toi, tu peux planter des végétaux spécifiques : le buddléia (l'"arbre à papillons"), l'ortie pour accueillir les chenilles des paons-du-jour, ou encore la lavande ou la sauge pour le nectar.
Attention toutefois aux variétés ornementales trop transformées : certaines plantes hybrides ont perdu leur attrait pour les insectes à force d'être modifiées. Garde donc autant que possible des espèces indigènes et sauvages, qui offrent une vraie valeur nutritive aux pollinisateurs. Et surtout, oublie un peu la tondeuse : laisse traîner des zones sauvages dans ton jardin, les insectes adorent ça !
Autres pollinisateurs : chauves-souris et oiseaux
Eh non, il n'y a pas que les abeilles et les papillons qui participent à la pollinisation ! Certaines chauves-souris sont particulièrement efficaces : par exemple, en Afrique et en Amérique centrale, ce sont elles qui pollinisent le fameux arbre à tequila, l'agave bleu. Elles glissent leur museau dans les fleurs ouvertes la nuit pour boire le nectar, transférant ainsi le pollen d'une plante à l'autre. Pratique hyper-spécifique qui rend ces chauves-souris indispensables à l'écosystème local et à l'économie régionale.
Coté oiseaux, les colibris jouent aussi un rôle clé en pollinisant près de 8 000 espèces de plantes différentes en Amérique. Leur spécialité ? Les fleurs tubulaires, impossibles à polliniser par d'autres animaux grâce à leur bec effilé et leur langue spécialement adaptée pour récupérer le nectar.
Si on veut donner un coup de main à ces pollinisateurs moins connus, on peut installer dans son jardin des plantes nectarifères à fleurs en forme de trompette pour attirer les colibris (comme la sauge rouge ou le chèvrefeuille), ou préserver des arbres fruitiers nocturnes pour favoriser les chauves-souris. Et puis éviter bien sûr lumières artificielles et pesticides, car les chauves-souris nocturnes sont très sensibles aux pollutions lumineuse et chimique.
L'importance de la pollinisation pour la biodiversité agricole
Amélioration des rendements agricoles
Les cultures qui profitent directement des pollinisateurs voient leur rendement grimper de manière nette : jusqu'à environ 30 % de hausse pour les pommiers et même 40 % pour certains oléagineux comme le colza, selon plusieurs études. Pas juste une question de quantité non plus : la qualité des récoltes est clairement améliorée, avec des fruits plus gros, mieux formés et uniformes, ce qui donne des récoltes moins gaspillées et plus vendables. Pour obtenir ces bénéfices, une astuce toute simple en agriculture, c'est d'installer des haies végétales près des champs : ces petites "zones refuges" attirent naturellement les insectes pollinisateurs. Autre solution pratique : intégrer des bandes fleuries directement dans les exploitations agricoles, ça favorise concrètement la biodiversité locale tout en accroissant rapidement les visites d'abeilles et autres insectes sur les cultures. Bref, plus de pollinisateurs présents et bien nourris, c'est clairement plus de volume récolté, des profits intéressants pour l'agriculteur et au bout du compte, de meilleures récoltes pour tout le monde.
Diversification de la production alimentaire
En intégrant des cultures diversifiées qui attirent une grande variété de pollinisateurs, tu boostes tes récoltes et renforces ton exploitation. Par exemple, planter en bordure de champ un mélange varié de fleurs riches en nectar et en pollen (comme le trèfle, la bourrache, ou la phacélie) attire non seulement les abeilles, mais aussi d'autres insectes utiles qui favorisent la pollinisation des légumes et fruits voisins. Pense aussi aux cultures intercalaires : semer du basilic entre tes plants de tomates ou des carottes près des oignons peut augmenter ta biodiversité agricole tout en réduisant naturellement les nuisibles grâce à l'action croisée des plantes compagnes. Et si tu veux aller encore plus loin, pourquoi ne pas réintroduire des variétés anciennes ou locales ? Elles sont souvent mieux adaptées aux pollinisateurs indigènes et plus résistantes face aux maladies ou variations climatiques. Une façon simple, efficace et concrète d'améliorer la production tout en protégeant les pollinisateurs.
| Action de conservation | Pollinisateurs concernés | Bénéfices attendus |
|---|---|---|
| Plantation de haies et de bandes fleuries | Abeilles, papillons, bourdons | Augmentation des habitats et des ressources alimentaires |
| Utilisation de pesticides bio ou réduction de l'usage des pesticides | Tous les pollinisateurs | Diminution de la mortalité due aux substances chimiques |
| Pratique de l'agriculture biologique et diversification des cultures | Abeilles domestiques et sauvages, syrphes | Amélioration de la santé des pollinisateurs et renforcement de la résilience des écosystèmes |
Menaces pesant sur les pollinisateurs
L'utilisation des pesticides
Impacts des néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes, ces insecticides puissants, attaquent directement le système nerveux des insectes. Même à de très faibles doses, leurs effets sont visibles : perte d'orientation, difficultés à retrouver la ruche ou le nid, problèmes de reproduction et affaiblissement général des colonies d'abeilles domestiques et sauvages. Mais attention, ces produits ne touchent pas seulement les abeilles, ils affectent aussi d'autres pollinisateurs clés, comme certains papillons ou même des coléoptères. Par exemple, une étude menée en France a révélé qu'autour des champs de colza traités au thiaméthoxame, une chute drastique de près de 30% des colonies d'abeilles survient en une saison seulement. Concrètement, ça signifie qu'une ruche entière peut disparaître en quelques mois après exposition répétée. Pour limiter ces impacts dans votre propre pratique agricole ou jardinage, choisissez des semences non traitées, demandez explicitement à votre fournisseur s'il utilise ces produits, et optez toujours pour une gestion intégrée des nuisibles plutôt qu'un recours automatique aux pesticides.
Exposition chronique et effets sublétaux
Quand les pollinisateurs comme les abeilles ou les papillons sont exposés régulièrement à de faibles doses de pesticides comme les néonicotinoïdes, les dégâts se cumulent avec le temps, même si au départ rien ne semble alarmant. Cette exposition chronique entraîne des effets sublétaux (qui ne tuent pas directement mais perturbent sérieusement leurs capacités). Par exemple, les abeilles perdent leur orientation et ne retrouvent plus leur ruche, ce qui diminue la force de la colonie. Concrètement, même une petite exposition peut réduire la capacité de reproduction des bourdons et perturber l'apprentissage olfactif des abeilles sauvages, les empêchant de repérer correctement les fleurs à polliniser. Donc, côté actions concrètes, mieux vaut vraiment éviter les traitements pesticides préventifs systématiques, privilégier les heures où les pollinisateurs ne sont pas actifs pour effectuer les pulvérisations (comme au coucher du soleil), et adopter des alternatives biologiques ou mécaniques quand c'est possible.
La perte d'habitat
Urbanisation et fragmentation du territoire
L'étalement urbain divise les espaces naturels en îlots isolés, ce qu'on appelle la fragmentation écologique. Concrètement, une ville qui grandit coupe les routes migratoires des pollinisateurs et les empêche de se déplacer librement pour trouver nourriture, partenaires, ou sites de nidification. Par exemple, en région parisienne, une étude de 2019 montre que le réseau d'autoroutes bloque clairement la circulation de certaines abeilles sauvages, comme Andrena vaga, qui préfèrent rester dans un même corridor plutôt que traverser un gros axe bétonné.
Pour améliorer ça, plusieurs villes européennes, comme Utrecht aux Pays-Bas, expérimentent la création de corridors verts en végétalisant les toits des abribus ou en plantant des prairies fleuries le long des pistes cyclables. Ça permet aux insectes de circuler facilement entre différents lieux de vie malgré le béton et l'asphalte. Des petites actions à la portée des municipalités (et même à l'échelle citoyenne), comme installer des jardinières avec des plantes nectarifères sur les rebords de fenêtres, font notamment une vraie différence pour garder connectés les milieux naturels urbains.
Monocultures agricoles intensives
Les champs immenses plantés d'un seul type de culture comme le maïs, le soja ou le colza peuvent sembler pratiques, mais ils sont mauvais pour la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ces cultures fleurissent toutes en même temps sur une très courte période, offrant aux pollinisateurs comme les abeilles une abondance de nourriture soudaine, puis plus rien du tout. C'est un peu comme ouvrir un buffet à volonté pendant quelques jours, puis fermer d'un coup : pas franchement une situation durable.
Du coup, les abeilles et autres pollinisateurs manquent rapidement de sources alimentaires variées nécessaires à leur bon développement. Sans diversité florale à proximité, ils doivent parcourir de longues distances pour trouver une nourriture adaptée. Résultat : ils s'épuisent, leurs colonies s'affaiblissent et leur taux de reproduction diminue.
Pour limiter concrètement ces dégâts, les agriculteurs peuvent planter des bandes fleuries avec des espèces variées autour ou entre leurs cultures principales. Par exemple, semer du trèfle blanc, de la phacélie ou du sainfoin autour d'un champ de maïs permet d'offrir une source de pollen et de nectar continue toute l'année. Ça aide à maintenir les populations de pollinisateurs en bonne santé, tout en favorisant la régénération des sols. C'est simple, rentable à moyen terme, et tout le monde y gagne, des abeilles jusqu'à l'agriculteur.
Changements climatiques
Décalages phénologiques et perturbations écologiques
Avec le réchauffement climatique, beaucoup de plantes fleurissent de plus en plus tôt dans l'année, parfois jusqu'à 2 à 4 semaines d'avance selon des études menées en Europe. Bien sûr, tu peux te dire que c'est sympa de voir arriver le printemps tôt, mais pour certains pollinisateurs, c'est une vraie galère. Par exemple, le bourdon terrestre (Bombus terrestris) émerge en général à la fin de l'hiver. Le hic, c'est qu'avec ces décalages, il se retrouve parfois actif alors que ses fleurs préférées n'ont pas encore fleuri ou ont déjà passé leur pic de nectar. En conséquence, il a du mal à se nourrir, et cela pèse sur ses chances de survie.
Et c'est pas juste les bourdons : les pollinisateurs ont souvent évolué pour se synchroniser parfaitement avec les floraisons, en des milliers d'années. Quand cette coordination se casse la figure, on parle de perturbations écologiques, et ça se répercute dans tout l'écosystème agricole. Par exemple, si des abeilles solitaires ou papillons émergent lorsque les pommiers ont déjà fini de fleurir prématurément, ça diminue les rendements des vergers de pommes.
Une solution concrète et facile à mettre en œuvre pour limiter ce genre de problèmes : planter ou favoriser des variétés aux périodes de floraison différentes et étalées dans le temps, pour garantir de la nourriture aux pollinisateurs malgré ces décalages saisonniers. On peut aussi laisser des zones semi-sauvages autour des champs pour offrir un buffet nectarifère permanent à disposition. Ces petites actions apportent un vrai coup de pouce à nos pollinisateurs confrontés aux bouleversements climatiques.
Effets sur la distribution géographique des pollinisateurs
Avec le réchauffement climatique, certaines espèces de pollinisateurs montent progressivement en altitude ou migrent vers le nord pour suivre les températures auxquelles elles se sont adaptées. Un exemple concret, c'est celui du bourdon terrestre (Bombus terrestris) : auparavant limité aux régions méridionales, on l'observe maintenant de plus en plus fréquemment dans le nord de l'Europe, comme en Scandinavie. Idem avec certains papillons comme l'Argus bleu, désormais signalé plus haut en altitude dans les Alpes. Côté action, il devient important de structurer des corridors écologiques adaptés à ces changements migratoires pour leur permettre de bouger sans trop galérer entre les espaces naturels. En gros, il ne suffit pas de protéger des petites réserves isolées, on doit aussi penser à leur assurer une réelle continuité territoriale pour faciliter cette adaptation rapide aux nouvelles réalités climatiques.


5%
augmentation par an
L'augmentation annuelle du revenu agricole dans les régions où les pollinisateurs sont gérés de manière durable.
Dates clés
-
1962
Publication du livre 'Printemps silencieux' par Rachel Carson, alertant sur les impacts des pesticides sur la biodiversité et marquant un tournant majeur de la prise de conscience mondiale.
-
1992
Signature de la Convention sur la diversité biologique lors du Sommet de la Terre à Rio, reconnaissant officiellement l’importance de la biodiversité, dont les pollinisateurs, pour la durabilité agricole.
-
2006
Premier signe important du syndrome d'effondrement des colonies (CCD) observé aux États-Unis, alertant massivement l'opinion publique sur le déclin des pollinisateurs.
-
2013
L'Union Européenne vote un moratoire partiel sur plusieurs néonicotinoïdes, en réponse aux preuves croissantes de leurs impacts néfastes sur les abeilles et autres pollinisateurs.
-
2016
Publication d'un rapport majeur de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), évaluant le déclin mondial des pollinisateurs et proposant des actions-clés pour leur sauvegarde.
-
2018
L'Union Européenne étend l'interdiction des néonicotinoïdes à toutes les utilisations en plein air, soulignant l'urgence de mesures plus fortes pour protéger les pollinisateurs.
-
2019
Lancement officiel en France du Plan National d'Actions 'France, terre de pollinisateurs', visant à enrayer le déclin des pollinisateurs par des mesures concrètes sur le terrain, associant citoyens, agriculteurs et collectivités locales.
-
2021
L'Assemblée nationale française adopte définitivement le projet de loi réintroduisant temporairement l'autorisation de certains néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière, provoquant débats et controverses environnementales.
Actions clés pour la conservation des pollinisateurs
Préservation des habitats naturels
Création de corridors écologiques
L'idée derrière les corridors écologiques, c'est simple : créer des chemins naturels pour aider les pollinisateurs à naviguer entre différents habitats sans se heurter à des obstacles infranchissables comme les villes ou les zones agricoles intensives. Concrètement, ça passe par la mise en place de bandes végétales fleuries bordant routes et champs. Des projets sympas existent déjà, comme celui des Trames Vertes et Bleues en France, qui visent précisément à construire un réseau connecté d'espaces naturels pour permettre aux pollinisateurs et autres petites bêtes de circuler librement. Autres exemples réalisables facilement : installer des haies champêtres diversifiées ou mettre en place des îlots de fleurs sauvages dans les parcs municipaux. L'efficacité du truc dépend beaucoup de la continuité du réseau : plus c'est cohérent et relié, mieux c'est pour les abeilles sauvages, papillons, et même pour les chauves-souris qui utilisent ces corridors pour se repérer. Une étude menée aux Pays-Bas montre d'ailleurs clairement que la mise en réseau de bandes fleuries augmente significativement l'abondance et la diversité des pollinisateurs dans les alentours. Bref, il suffit parfois juste de les guider un peu pour leur simplifier la vie.
Réhabilitation des zones humides et prairies fleuries
Réhabiliter une zone humide, c'est d'abord retirer les espèces invasives, puis restaurer progressivement les niveaux d'eau naturels. Par exemple, dans les marais du Cotentin en Normandie, les gestionnaires favorisent la recolonisation par les végétaux locaux comme la massette ou la reine-des-prés pour ramener les insectes pollinisateurs. Pour une bonne prairie fleurie, l'astuce c'est de sélectionner des espèces locales adaptées, semées à la volée, sans engrais de synthèse. Évite de tondre trop court ou trop tôt : l'idéal, c'est d'attendre la fin de l'été pour laisser les plantes fleurir librement et favoriser la biodiversité. Certaines communes, comme Besançon, ont créé des prairies urbaines près des zones industrielles, et observent déjà un retour des abeilles sauvages. Pense aussi à laisser intacts quelques tas de bois ou petites zones ouvertes de terre nue pour que les insectes sauvages puissent s'abriter et nicher naturellement. C'est concret, facile, et ça marche vraiment vite pour ramener la vie.
Pratiques agricoles durables
Agriculture biologique et permaculture
L'agriculture biologique mise sur des techniques concrètes éliminant l'emploi de produits chimiques de synthèse. Ça implique notamment d'utiliser des engrais verts (légumineuses comme la luzerne ou le trèfle blanc), des auxiliaires naturels (coccinelles, chrysopes) pour contrôler les parasites, et des composts biologiques pour booster naturellement la fertilité des sols. Résultat : des champs accueillants pour les pollinisateurs, car exempts de perturbateurs chimiques.
La permaculture, elle, pousse l'idée encore plus loin. Plutôt que de séparer cultures et nature, elle intègre tout dans un écosystème cohérent. Très concret : elle exploite la complémentarité végétale et animale, diversifie les espèces présentes et optimise l'utilisation des ressources (eau, soleil, air). Exemple ? Installer des haies fleuries autour des cultures attire les pollinisateurs et réduit le besoin de traiter les champs contre les ravageurs. Certaines fermes françaises, comme la Ferme du Bec Hellouin en Normandie, montrent depuis des années l'efficacité économique d'une agriculture inspirée des principes permacoles, tout en protégeant activement les abeilles et autres pollinisateurs. Pas mal, non ?
Rotation des cultures et utilisation raisonnée des pesticides
Alterner les cultures, ça semble basique mais c'est une vraie stratégie pour limiter les parasites et donc réduire fortement la quantité de pesticides nécessaires. Par exemple, si tu enchaînes toujours la même plante comme le maïs au même endroit, les parasites spécialisés s'installent et prospèrent. Alors qu'en changeant régulièrement les types de cultures, tu pertubes leur développement. Une méthode simple et efficace : après une culture gourmande en azote comme le blé, tu plantes des légumineuses genre luzerne ou trèfle. Non seulement elles restaurent naturellement la fertilité du sol, mais en plus l'alternance empêche les ravageurs spécifiques de proliférer.
Côté pesticides, la règle c'est de traiter uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Rien ne sert de pulvériser par prévention toutes les deux semaines. Aujourd'hui, il existe des outils précis comme le suivi régulier des cultures et l'utilisation de seuils d'intervention. Par exemple, en arboriculture, certains producteurs suivent minutieusement la présence d'insectes comme le carpocapse à l'aide de pièges à phéromones. Dès qu'ils dépassent un seuil critique, là seulement ils interviennent et ça permet de limiter drastiquement l'usage du chimique. C'est bénéfique pour la santé du sol, les pollinisateurs et même à terme pour le portefeuille du fermier, vu les prix actuels des intrants chimiques.
D'ailleurs, pour aller encore plus loin, certains adoptent des approches intégrées, combinant pesticides naturels et lutte biologique. Exemple concret : introduire des insectes prédateurs comme les coccinelles contre les pucerons. Résultat, moins de pesticides, une agriculture plus saine et une biodiversité favorisée.
Programmes de sensibilisation
Éducation environnementale en milieux scolaires
Mettre en place des ateliers d'observation des pollinisateurs directement sur le terrain peut faire une grosse différence chez les élèves. Planter un petit jardin avec des fleurs mellifères dans la cour de l'école (par exemple lavande, coquelicot, bourrache) est une manière pratique de leur apprendre l'importance des espèces locales.
Il existe aussi des programmes très concrets comme "Sauvages de ma rue" lancé par le Muséum national d'Histoire naturelle. Ce projet propose une approche citoyenne et scientifique aux élèves : ils recensent la flore urbaine et découvrent ensemble la biodiversité à côté d'eux.
Inviter ponctuellement des apiculteurs locaux ou des spécialistes en écologie peut aussi rendre ces interventions plus vivantes, en expliquant simplement pourquoi et comment protéger les pollinisateurs. L'organisation d'activités très concrètes, comme construire des petits hôtels à insectes, offre une expérience plus directe, facile à reproduire à la maison avec les parents.
Un autre exemple efficace : le dispositif "Abeille, sentinelle de l'environnement" développé par l'Union Nationale de l'Apiculture Française, déjà déployé dans certaines écoles, aide les jeunes à comprendre clairement les enjeux. On peut aussi facilement télécharger et imprimer les fiches pédagogiques qu'ils mettent à disposition sur leur site, pour approfondir en classe.
Enfin, pour prolonger la sensibilisation, impliquer les élèves dans des projets de science participative comme "Spipoll" (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) est très concret : ils prennent eux-mêmes des photos des insectes dans leur environnement proche, les identifient, publient leurs données, et suivent ainsi l'évolution des pollinisateurs au fil du temps.
Foire aux questions (FAQ)
Les plantes mellifères comme la lavande, le trèfle, le thym, le bleuet ou encore l'échinacée attirent efficacement les pollinisateurs. Il est préférable de choisir des variétés locales ou indigènes à floraison étalée tout au long de l'année afin de leur fournir nectar et pollen sur une période aussi longue que possible.
Les néonicotinoïdes sont un groupe de pesticides particulièrement toxiques pour les pollinisateurs. Ils impactent le système nerveux des abeilles, engendrant désorientation, diminution de leur mémoire, perte de capacité à communiquer au sein de la colonie et, à terme, leur mort prématurée.
Vous pouvez cultiver des plantes nectarifères indigènes dans votre jardin ou sur votre balcon afin de créer des refuges pour les pollinisateurs. Il est également bénéfique d'éviter ou de limiter l'utilisation de pesticides chimiques, d'installer des hôtels à insectes et de sensibiliser vos voisins à ces pratiques.
Les pollinisateurs comme les abeilles, les papillons et certaines espèces d'oiseaux favorisent la fécondation des plantes en transportant le pollen d'une fleur à une autre, assurant ainsi la production de fruits, légumes et graines. Sans pollinisateurs, environ 75% des cultures alimentaires mondiales pourraient subir des pertes sévères de rendement, menaçant directement notre sécurité alimentaire.
Non, il existe une multitude d'autres pollinisateurs tout aussi précieux pour l'agriculture et la biodiversité : abeilles sauvages, papillons, mites, certaines espèces de chauves-souris et même des oiseaux comme les colibris jouent également un rôle crucial dans la pollinisation des plantes.
Certains indicateurs visibles incluent une réduction notable de la quantité de fruits et légumes produits localement, l'absence ou la rareté des insectes sur les fleurs, ou encore l'augmentation des fraises, courgettes ou tomates non ou mal fécondées dans votre jardin ou potager.
Le changement climatique perturbe les cycles de vie des pollinisateurs en modifiant les périodes de floraison des plantes (décalages phénologiques). Certains pollinisateurs peuvent ainsi ne plus trouver la nourriture nécessaire au moment adéquat, tandis que d'autres voient leur habitat rétrécir ou disparaître complètement en raison des variations climatiques.
Plusieurs associations et organismes spécialisés comme l'Office français de la biodiversité, la Société Nationale d'Horticulture de France, ou encore les associations locales de protection de la nature proposent des conseils pratiques, guides et événements d'information sur les bonnes pratiques pour préserver ces petites créatures si importantes.
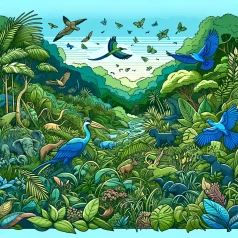
Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)
Quizz
Question 1/5
