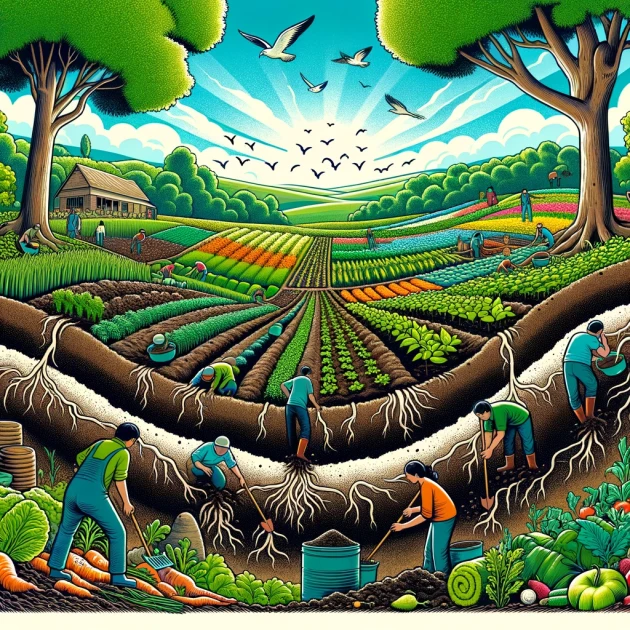Introduction
En plein débat sur la lutte contre le réchauffement climatique, une solution est sous nos yeux, pourtant souvent négligée : nos sols. À force de parler voitures électriques, panneaux solaires et réduction des énergies fossiles, on oublie facilement que le sol est un allié puissant contre le changement climatique. En gros, si on apprenait à mieux le connaître, à le garder vivant et en bonne santé, il pourrait même devenir notre meilleur atout pour inverser la tendance.
Pourquoi ça marche ? Parce que les sols ne sont pas juste de la « terre », ils constituent un réservoir naturel géant de carbone. Quand ils sont en bon état, ils captent le CO₂ présent dans l'air via les plantes, le stockent et nous débarrassent ainsi d'une bonne partie des gaz à effet de serre. Mais quand ils sont maltraités, dégradés ou surexploités, la machine se grippe complètement : ils recrachent le carbone capturé dans l'atmosphère et contribuent gravement au problème du climat. Pas cool du tout.
D'ailleurs, comme on maltraite justement pas mal nos sols depuis quelques décennies avec l'agriculture intensive, la déforestation et l'utilisation massive des pesticides, on est en train de perdre un potentiel énorme. Environ un quart des sols dans le monde est aujourd'hui sérieusement dégradé. Résultat : au lieu d'être un allié, notre terre devient une source de problèmes—moins fertile, moins vivante, entraînant donc plus de difficultés pour cultiver nos aliments.
Sauf que, bonne nouvelle, tout n'est pas perdu. Il existe déjà des solutions concrètes et accessibles pour restaurer durablement les sols. Des pratiques agricoles innovantes comme l'agriculture régénérative, l'agroforesterie, et la restauration raisonnée des pâturages gagnent du terrain. Ces approches permettent non seulement de produire mieux et de manière plus rentable à long terme, mais aussi de stocker des quantités impressionnantes de carbone sous terre, limitant ainsi nettement notre empreinte sur le climat.
Redonner vie à nos sols n'a rien d'une utopie inaccessible. Au contraire, on a tout à y gagner : meilleure sécurité alimentaire, biodiversité plus riche et climat stabilisé. Franchement, miser sur nos sols pour inverser la tendance climatique, c'est loin d'être idiot. C'est même sûrement l'une des initiatives environnementales les plus intelligentes qu'on puisse adopter dès maintenant.
2 milliards de tonnes
Les sols agricoles sont responsables du stockage de 2 milliards de tonnes de carbone chaque année.
33 en % des sols
Environ 33% des sols de la planète sont dégradés en raison de la déforestation, de l'érosion, et de la mauvaise gestion des terres.
2000 millions de tonnes
La dégradation des sols entraîne une perte annuelle d'environ 2000 millions de tonnes de carbone.
10 milliards d'hectares
Près de 10 milliards d'hectares de terres pourraient être régénérés grâce à des pratiques agricoles durables.
Comprendre le rôle fondamental des sols dans le changement climatique
Le sol : un puits de carbone naturel sous-estimé
Quand on pense stockage de carbone, on imagine plutôt les forêts amazoniennes ou l'océan. Mais on zap souvent que les sols contiennent environ 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère ! En fait, les premiers mètres de sol planétaire accumulent près de 1500 milliards de tonnes de carbone organique selon la FAO. Ça fait du sol un acteur majeur, mais pourtant sous-estimé à fond.
La matière organique du sol (racines mortes, feuilles décomposées, micro-organismes divers...) piège tout ce carbone tranquillement pendant des années, voire des siècles. Certains types de sols, comme les tourbières ou les sols prairiaux riches en humus, excellent dans cette fonction. Par exemple, en France, les tourbières représentent seulement 0,2 % de la superficie nationale, mais stockent quasiment autant de carbone que toutes nos forêts réunies !
Le hic ? Lorsqu'on exploite intensivement les terres agricoles ou qu'on assèche des tourbières, tout ce stock part en fumée (façon de parler : clairement, surtout sous forme de CO₂ vers l’atmosphère). Selon une étude d'experts internationaux publiée dans "Nature", cette dégradation des sols libérerait chaque année entre 1,6 et 4,4 milliards de tonnes de carbone, aggravant sérieusement le réchauffement climatique au lieu de le freiner.
Réhabiliter ces sols, en revanche, peut inverser cette tendance. Une gestion optimale pourrait permettre d'emmagasiner annuellement jusqu'à 1,85 milliard de tonnes de carbone supplémentaires dans les sols du monde entier, d’après les projections du GIEC. Voilà pourquoi miser sur les sols est une stratégie climatique qui pourrait carrément changer la donne.
L'interaction sol-plante-atmosphère
Les plantes, les sols et l'atmosphère forment ensemble un système vivant en échange continu. Quand une plante fait sa vie, qu'elle pousse tranquillement, elle respire et relâche du CO₂ : c'est classique. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que près d'un quart du carbone capturé par une plante lors de la photosynthèse termine dans le sol. La plante donne littéralement à manger aux micro-organismes du sol, sous forme d'exsudats sucrés qu'elle sécrète au niveau des racines. En échange de ce festin, bactéries, champignons et autres habitants du sol décomposent matières organiques et minéraux, permettant ainsi à la plante de puiser les nutriments indispensables à sa croissance. Un vrai donnant-donnant souterrain.
Cette relation discrète aide à réguler le climat au niveau global. Exemple concret : lorsqu'une plante pousse sur un sol sain riche en carbone organique, elle absorbe efficacement davantage de CO₂ atmosphérique. Un sol appauvri ou dégradé réduit considérablement sa capacité de stockage de carbone, rompant brutalement cet équilibre naturel. Et pour couronner le tout, les perturbations climatiques que nous vivons renforcent ce cercle vicieux : plus il fait chaud, plus un sol pauvre relâche de gaz à effet de serre vers l'atmosphère, aggravant encore le réchauffement.
La bonne nouvelle c'est que l'on peut rétablir ce cercle vertueux en favorisant une meilleure gestion des sols, en renforçant leur vie biologique et en prenant soin de leur santé globale. Quand sols, végétaux et atmosphère bossent ensemble en harmonie, les gains climatiques sont considérables et bien réels.
| Type de sol | Taux de séquestration du carbone (tonnes de CO2/ha/an) | Exemple de pratiques agricoles |
|---|---|---|
| Terre arable | 0,4 - 0,8 | Agriculture régénérative, couverture végétale permanente |
| Prairies | 0,9 - 2,4 | Rotation de cultures variées, pâturage tournant |
| Forêts | 2,1 - 4,3 | Agroforesterie, reforestation |
Les sols menacés : défis actuels à surmonter
Émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture
Dégradation généralisée des sols
Érosion et perte de fertilité
Quand on perd seulement 10 cm de terre végétale par érosion, il faut parfois plus de mille ans pour refaire cette couche fertile. C'est comme voir ton compte bancaire se vider sans possibilité de remettre de l'argent rapidement ! Par exemple, dans certaines zones du Sud-Ouest de la France, on constate des pertes dépassant 20 tonnes de sol par hectare chaque année à cause de l'érosion hydrique lors des orages intenses. Les couverts végétaux, les haies bocagères et les rotations de cultures diversifiées sont des outils concrets pour réduire massivement l'érosion. Des mesures simples existent aussi : limiter le labour intensif, appliquer des techniques comme le semis direct, ou garder les résidus de récolte au sol pour assurer une protection permanente. En pratique, un sol protégé permet non seulement de maintenir sa fertilité, mais aussi de conserver une efficacité agricole durable et rentable pour le fermier.
Appauvrissement en matière organique
La perte de matière organique dans les sols, c'est pas juste une histoire de fertilité réduite. Concrètement, moins de matière organique, ça veut dire des sols qui retiennent moins d'eau et fournissent moins de nutriments aux plantes. Par exemple, les champs cultivés intensivement perdent souvent jusqu'à 50 à 60 % de leur matière organique initiale après seulement quelques décennies. À l'inverse, si tu augmentes d'à peine 1 % la matière organique sur les premiers 30 cm de ton sol, tu peux stocker environ 27 tonnes de carbone supplémentaires par hectare. Ça équivaut quasiment aux émissions annuelles de quelques foyers français. Du coup, plutôt que de retourner constamment le sol ou de le laisser nu, intégrer des pratiques comme les cultures de couverture, l'apport régulier de compost ou le non labour permet de restaurer cette matière organique assez efficacement (et même rapidement dès les premiers 3 à 5 ans). C'est simple, pas hors de prix, et c'est à portée de main.
Pertes significatives de biodiversité agricole
La FAO estime qu'en seulement cent ans, on a perdu environ 75% des variétés végétales cultivées dans le monde. Par exemple, autrefois, rien qu'en France, des centaines de variétés locales de pommes ou de tomates avaient chacune leurs saveurs, leurs résistances aux maladies et leurs adaptations à des conditions spécifiques. Aujourd'hui, la majorité de ces variétés disparaissent, remplacées par des variétés hybrides standardisées, sélectionnées pour leur rendement et une conservation plus facile après récolte.
Idem pour les animaux d'élevage, une poignée de races productives domine l'agriculture moderne. À titre d'exemple concret : en élevage bovin, cinq races principales à peine assurent la majorité absolue de la production laitière mondiale, menaçant ainsi de disparition totale près de 20% des races bovines actuellement répertoriées.
Cette perte des variétés agricoles équivaut aussi au déclin spectaculaire de tout un écosystème vivant autour de cultures et pâturages diversifiés : insectes bénéfiques (pollinisateurs, prédateurs naturels des ravageurs), micro-organismes du sol, petits mammifères et oiseaux n'ont plus leur place dans ces espaces agricoles uniformisés. Un rapport publié en 2019 par IPBES (la plateforme mondiale dédiée à la biodiversité) souligne que la diversité génétique agricole constitue pourtant l'une des clés essentielles pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires face au changement climatique. Moins de biodiversité génétique, c'est moins d'options disponibles pour s'adapter aux maladies émergentes, aux invasions de ravageurs inconnus ou aux événements climatiques extrêmes.
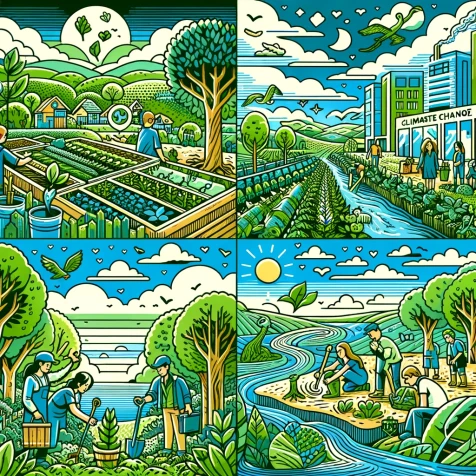

135
milliards de dollars
La dégradation des sols coûte environ 135 milliards de dollars par an en pertes de rendement agricole.
Dates clés
-
1928
Découverte de la technologie de conservation des sols par Hugh Hammond Bennett aux États-Unis.
-
1992
Signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro.
-
2015
Accord de Paris sur le climat, adopté par 195 pays, visant à limiter le réchauffement climatique.
-
2019
Lancement de l'Initiative 4 pour 1000, visant à accroître la teneur en carbone organique des sols de 0,4 % par an.
Le potentiel insoupçonné des sols pour inverser la tendance climatique
Séquestration efficace du carbone
Mécanismes naturels de stockage de carbone
Quand les plantes poussent, elles absorbent du CO₂ de l’atmosphère via la photosynthèse, transformant une partie de ce carbone en sucres et biomasse. Une grosse proportion finit ensuite dans le sol grâce aux racines et aux exsudats (des sucres et nutriments libérés par les racines pour nourrir les petits organismes souterrains). Ces sucres attirent les micro-organismes comme les bactéries et champignons symbiotiques (par exemple les mycorhizes), qui se nourrissent de ces composés carbonés et stockent durablement ce carbone sous terre sous forme de matière organique stable (humus). Autre exemple parlant : les prairies permanentes et les sols couverts de manière continue séquestrent souvent davantage de carbone sous terre que les sols cultivés en monoculture annuelle, grâce à leurs racines profondes et à la grande quantité de biomasse souterraine. Plus la biodiversité microbienne et végétale est riche dans le sol, plus ce processus est efficace. C’est simple mais extrêmement efficace pour retirer massivement du carbone de l’atmosphère.
Estimations mondiales et potentiel chiffré
Aujourd'hui, à échelle mondiale, les sols stockent environ 1500 à 2500 gigatonnes de carbone organique. C'est presque deux à trois fois plus que ce qui flotte déjà dans l'atmosphère sous forme de CO₂. Ce chiffre donne une sacrée perspective : en améliorant seulement de 0,4% par an la quantité de carbone dans le sol grâce à des pratiques agricoles améliorées et des méthodes de gestion adéquates, on pourrait compenser toute l'augmentation annuelle des émissions de CO₂ dues aux activités humaines. Par exemple, certaines études démontrent qu'en passant au bio ou à l'agriculture régénérative, une exploitation peut stocker jusqu'à 3 tonnes supplémentaires de carbone organique par hectare chaque année. Avec environ 1,5 milliard d'hectares cultivés dans le monde aujourd'hui, le potentiel global est énorme. Un rapport récent du GIEC (2019) le confirme : rien qu'une meilleure gestion des terres agricoles pourrait piéger jusqu'à 9 milliards de tonnes de carbone par an d'ici 2050. Pas besoin de miracle techno compliqué : planter des cultures couvrantes, arrêter de labourer excessivement, restaurer les prairies naturelles ou introduire des arbres dans les parcelles agricoles suffiraient souvent à enclencher le processus. Bref, on tient là un vrai levier d'action concret et à portée de main.
Biodiversité et écosystèmes du sol
Micro-organismes : des alliés indispensables dans la lutte climatique
Les champignons mycorhiziens jouent un rôle clé dans le stockage du carbone. Ils créent des partenariats avec les racines des plantes et augmentent leur capacité à absorber l'eau et les nutriments, ce qui booste la croissance végétale et piège davantage de carbone dans le sol. Par exemple, dans des sols agricoles traités avec des inoculants mycorhiziens, la séquestration du carbone a pu augmenter jusqu'à 15 % par rapport aux sols conventionnels.
Autre exemple, certaines bactéries, comme les rhizobiums, transforment l'azote atmosphérique en azote assimilable directement par les plantes (on appelle ça la fixation biologique de l'azote). Ça permet de réduire sérieusement la dépendance aux engrais chimiques, qui sont responsables d'importantes émissions de protoxyde d'azote (N₂O), un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO₂.
Un truc très concret à faire pour activer ces alliés naturels : adopter des pratiques agricoles comme les couvertures végétales en interculture ou l'intégration de cultures légumineuses (lentilles, fèves, trèfle). Ça améliore directement la diversité des micro-organismes du sol et son potentiel carbone, en plus de réduire les coûts liés aux intrants chimiques.
Interactions complexes entre les sols, les végétaux et le climat
Quand on regarde sous nos pieds, les sols ne sont pas seulement de la "terre" : il y a un sacré ballet vivant qui relie directement les plantes au climat. Les végétaux libèrent des exsudats racinaires, sorte de cocktails nutritifs, pour nourrir microbes et champignons du sol. Ces partenaires microscopiques rendent en retour des nutriments accessibles aux plantes, boostant leur santé et leur croissance. Et une plante en bonne forme, ça veut dire une plus grande capacité à capter le CO2 atmosphérique via la photosynthèse.
Plus intrigant : les micro-organismes du sol peuvent influencer carrément la résistance des plantes face à la sécheresse ou à la chaleur extrême, des conditions climatiques qui se multiplient avec le réchauffement global. Par exemple, certaines études montrent que des mycorhizes—ces champignons symbiotiques connectés aux racines—augmentent clairement la résilience des cultures agricoles dans des régions arides comme au Sahel.
Un sol riche et bien nourri favorise aussi un phénomène appelé transpiration végétale, où l'eau absorbée par les racines s'évapore par les feuilles. Cette vapeur d'eau relâchée par les végétaux contribue localement à rafraîchir l'air dans les périodes de canicule. Concrètement, dans les systèmes agroforestiers où l'on combine arbres, arbustes et cultures, on a mesuré des différences de température allant parfois jusqu'à 5 à 10°C par rapport à des champs ouverts classiques en pleine chaleur estivale.
Autre aspect actionnable : veiller à avoir une couverture végétale permanente ou quasi-permanente sur les sols (couverture végétale permanente) permet de maintenir leur humidité, de réduire leur température de surface et d'éviter l'érosion. Résultat : non seulement les terres captent davantage de carbone, mais les fermiers économisent aussi sur l'irrigation. Tout bénéf' pour l'environnement et le porte-monnaie.
Bref, comprendre ces liens précis entre végétaux, sols vivants et climat permet vraiment de guider les pratiques agricoles vers celles qui donnent des résultats concrets, pratiques, et durables.
Le saviez-vous ?
Les sols contiennent environ 2 à 3 fois plus de carbone que l'atmosphère, et il est possible de stocker davantage de carbone dans les sols pour aider à lutter contre le changement climatique.
La dégradation des sols coûte à l'économie mondiale environ 10 milliards de dollars par an, principalement en raison de la perte de productivité agricole et des coûts liés à l'érosion et à la désertification.
Les vers de terre peuvent ingérer leur propre poids en terre chaque jour, favorisant ainsi la circulation de l'air et des nutriments dans le sol.
Solutions agricoles durables : nourrir et restaurer les sols
Agriculture régénérative
Principes fondamentaux et méthodes pratiques
L'agriculture régénérative vise en priorité à remettre de la vie dans le sol pour le rendre plus riche et capter le carbone. Concrètement, ça passe d'abord par un minimum de travail mécanique (ou même zéro labour), car labourer intensivement libère le carbone enfermé dans le sol depuis longtemps. Autre conseil pratique : toujours avoir un couvert végétal permanent avec des engrais verts comme la moutarde, le trèfle, ou le radis fourrager, qui protègent le sol, limitent les mauvaises herbes et nourrissent directement les organismes souterrains.
Côté fertilisation organique, le compostage à la ferme est ultra efficace car il recycle directement les matières organiques et booste la vie microbienne. Pas besoin d'être expert : même les petits agriculteurs peuvent monter un compost adapté, avec simplement des déchets végétaux, du fumier animal et une bonne gestion de l'humidité.
Une pratique à retenir aussi, peut-être moins connue, c'est l'utilisation du pâturage tournant dynamique (comme le fait la Ferme du Bec Hellouin par exemple). On déplace régulièrement les animaux sur des petites parcelles pour leur laisser le temps de se régénérer naturellement : cela stimule beaucoup plus l'enracinement profond des plantes, améliore la structure du sol, multiplie la diversité végétale spontanée, et du coup stocke davantage de carbone chaque année.
Enfin, intégrer l'agroforesterie (planter des arbres isolés ou en rangées sur les parcelles agricoles) apporte énormément : c'est à la fois bon pour l'ombrage, le microclimat, la biodiversité, et permet de ralentir l'érosion des sols dès les premières années. Certaines essences comme le robinier faux-acacia ou le noyer apportent même des bonus économiques avec leur bois ou leurs produits dérivés. Bref, des solutions concrètes que tout agriculteur motivé peut tester sur ses propres terres.
Bénéfices économiques et écologiques avérés
L'agriculture régénérative c'est du concret, à la fois bénéfique pour la planète et avantageux côté portefeuille. Des producteurs comme ceux du ranch Brown aux États-Unis ont vu leurs coûts en engrais chimiques et en pesticides plonger de plus de 60 % en adoptant des pratiques régénératives comme le pâturage tournant, le semis sous couvert, et l'arrêt du labour. Résultat : le sol se revitalise, les rendements se stabilisent naturellement, et la dépendance aux intrants chute. En France aussi, certains agriculteurs constatent une hausse des marges nettes de 25 à 40 % après quelques années de pratiques régénératives.
Côté environnemental, les résultats sont tout aussi palpables : une étude réalisée sur 20 exploitations pilotes par l'INRAE a montré que le stockage de carbone dans le sol augmentait de manière significative (jusqu'à 2 tonnes de carbone par hectare et par an) après passage à l'agriculture régénérative. Autrement dit, une vraie absorption du CO₂ atmosphérique, qui réduit concrètement les émissions globales. Bonus supplémentaire : l'amélioration de la structure du sol permet aussi une meilleure gestion de l'eau—jusqu'à 30 % d'augmentation de la capacité de rétention d'eau du sol. Pas négligeable face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.
En gros, adopter ces pratiques, c'est gagnant-gagnant : des économies d'argent immédiates en intrants, des sols en meilleure santé qui absorbent du carbone à pleine capacité, des exploitations plus résilientes face au changement climatique. De l'écologie intelligente quoi !
Agroforesterie et pratiques agroécologiques
Définitions, concepts clés et typologies
L'agroforesterie c'est concret : planter des arbres ou arbustes avec des cultures agricoles ou élevages pour créer une combinaison maligne d'écosystèmes. Par exemple, en associant des arbres fruitiers à des céréales ou à des animaux qui paissent dessous, ça coupe le vent, apporte de l'ombre, protège les sols, limite l'érosion, et ça stocke un carbone précieux dans le sol et la biomasse végétale. Il existe plusieurs typologies pratiques : les systèmes sylvo-arables mélangent arbres et cultures agricoles classiques, type céréales ou légumes; les systèmes sylvo-pastoraux combinent arbres et pâturages pour l'élevage; et les haies bocagères, ces alignements d'arbustes ou petits arbres autour ou dedans pour clôturer et protéger des parcelles. L'agroécologie, elle, est plus large : c'est carrément une approche agricole construite autour des interactions positives entre les plantes, animaux, sols et milieu local. Ça marche en s'appuyant sur la biodiversité, sans pesticides ni engrais chimiques, et en privilégiant rotations culturales intelligentes, compostage maison, couvertures végétales permanentes pour protéger le sol toute l'année—comme lorsque les agriculteurs bretons sèment un mélange de trèfle et de seigle après leurs récoltes principales, ce qui enrichit naturellement leur sol tout en piégeant du carbone. On peut donc agir vite en adoptant ces solutions qui existent, qui fonctionnent et qui changent la donne climatiquement.
Résultats scientifiques confirmés sur la mitigation climatique
Planter des arbres au milieu de champs agricoles ou pratiquer le couvert végétal ne sont pas juste de bonnes idées intuitives, ça cartonne vraiment côté climat selon pas mal de recherches sérieuses. Une étude menée au Malawi en 2017 a démontré que l'agroforesterie pouvait stocker jusqu'à 3 fois plus de carbone dans les sols que l'agriculture classique, sur seulement quelques années. Ça c'est vraiment du concret : imagine ce que donnerait une généralisation à large échelle !
Autre exemple efficace : en France, l'INRAE a confirmé que garder les sols toujours couverts (intercultures, légumineuses, couverts permanents) augmente l’accumulation de matière organique et dope sacrément le stockage carbone (environ 0,2 à 1 tonne supplémentaire par hectare chaque année suivant les régions et les systèmes agricoles testés). Des chiffres vérifiés en conditions réelles, qu'on peut appliquer facilement chez soi sans investissement énorme.
Et puis, le CIRAD a bossé au Brésil et dans plein d'autres pays tropicaux sur des systèmes agroécologiques diversifiés : résultat, moins d'engrais chimiques, plus de carbone retenu au niveau racinaire et une fertilité des sols boostée. Concrètement, ils ont mesuré jusqu’à 40 % de réduction des émissions de N2O (un gaz bien nocif) sur ces pratiques agroécologiques.
Bref, des solutions vérifiées scientifiquement existent, faciles à mettre en œuvre sur le terrain et efficaces quasi immédiatement. Pas besoin d'attendre 50 ans ou de parier sur des technos compliquées et chères. Autant se lancer, non ?
Gestion raisonnée et restauration des pâturages
Depuis quelques années, on réalise l'énorme potentiel d'une gestion raisonnée des pâturages pour piéger du carbone dans les sols. Concrètement, alterner régulièrement les zones de pâturage permet à l'herbe et aux sols de récupérer, de booster leur matière organique et d'améliorer leur structure. Résultat : les sols stockent mieux le carbone, limitent l'érosion et conservent plus longtemps leur humidité. Une étude de l'INRAE montre par exemple que les pâturages correctement gérés peuvent augmenter leur stock de carbone dans le sol de 0,5 à 1 tonne par hectare chaque année. Pas mal, non ? À l'inverse, quand on surcharge les animaux au même endroit longtemps, le sol s'épuise et libère du carbone dans l'atmosphère. Concrètement, ça signifie qu'une rotation bien pensée, avec des périodes courtes et régulières de pâturage intense suivies de repos prolongés, restaure la biodiversité au niveau des sols et leur capacité à stocker durablement du carbone. Certaines fermes françaises pratiquant ce modèle observent même une nette amélioration de leurs rendements fourragers, jusqu’à 20 à 30% supplémentaires à conditions équivalentes. C'est gagnant-gagnant : plus fertile, plus riche en biodiversité et meilleur pour le climat. Cette méthode, appelée parfois pâturage tournant dynamique, commence enfin à se répandre concrètement sur le terrain, offrant aux éleveurs une solution à la fois rentable et climato-compatible.
Foire aux questions (FAQ)
La séquestration du carbone dans les sols implique le stockage du dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique dans les sols agricoles, ce qui contribue à réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Les plantes absorbent le CO2 par la photosynthèse, et une partie de ce carbone est ensuite transférée dans les racines et le sol.
La régénération des sols peut être favorisée par des pratiques agricoles telles que la rotation des cultures, la couverture végétale des sols, l'agroforesterie, l'utilisation de compost et de fumier, et la limitation du labourage, entre autres.
La régénération des sols peut améliorer la rétention d'eau, la fertilité et la structure du sol, ce qui peut aider à atténuer les effets des sécheresses et des précipitations extrêmes associées au changement climatique.
La régénération des sols peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la biodiversité, restaurer la fertilité des sols et réduire l'érosion, ce qui présente divers avantages environnementaux.
Les sols constituent un habitat vital pour de nombreuses espèces, notamment les micro-organismes, les insectes et d'autres organismes bénéfiques pour la biodiversité. Préserver la santé des sols est donc essentiel pour protéger la biodiversité terrestre.

100%
Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !
Quizz
Question 1/5