Introduction
Les océans ne servent pas seulement à prendre de jolies photos à poster sur Instagram pendant nos vacances. Ils renferment aussi un potentiel gigantesque d'énergie propre, prête à être exploitée. Vagues, courants, marées ou même différences de températures dans l'eau : tout ça, c'est de l'énergie renouvelable dont on commence à peine à saisir l'ampleur. Alors comment capturer efficacement cette énergie marine ? Quelles technologies existent déjà, et lesquelles pourraient bientôt changer la donne ? Et puis, côté environnement et société, quelles sont les précautions à prendre pour éviter de faire plus de mal que de bien ? On parlera réglementation, aussi, parce que forcément, à chaque nouveau projet, il y a son lot de règles. Enfin, concrètement, ça donne quoi niveau géographie et création d'emplois ? Cet article va plonger dans ces questions-là, histoire d'y voir plus clair sur une ressource prometteuse pour la transition énergétique. Attache ta ceinture et prends ta combinaison de plongée, on part explorer les énergies marines renouvelables !10 millions de tonnes
Le nombre de tonnes de CO2 économisées grâce à l'énergie marémotrice dans le monde
220 millions
Le nombre d'emplois attendus dans le secteur des énergies renouvelables dans le monde d'ici 2030
70 %
La part de la consommation énergétique totale de l'Islande provenant de l'énergie géothermique
1.4 gigawatts
La puissance mondiale cumulée installée des technologies houlomotrices en 2020
Introduction aux énergies marines renouvelables
Les énergies marines renouvelables (EMR), c'est quoi exactement ? Imaginez utiliser la puissance des océans pour produire une énergie propre et quasiment infinie. Ça regroupe surtout l'énergie des marées, des vagues, les courants sous-marins, ainsi que la différence de température entre les eaux de surface et celles en profondeur. C'est une option intéressante pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. Ces ressources marines offrent souvent une production prévisible et régulière, contrairement au solaire ou à l’éolien qui peuvent être intermittents. Autre avantage : les océans recouvrent plus de 70 % de notre planète, ce qui signifie un potentiel énorme pour tenter de répondre aux besoins croissants en énergie durable. Pourtant, malgré tous ces atouts, les technologies EMR restent encore peu exploitées à grande échelle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que leur mise en œuvre est assez complexe, coûteuse, et demande parfois des infrastructures spécifiques en mer. Mais les bénéfices potentiels — en termes d'environnement, d'emploi et d'énergie locale — en valent clairement la peine.
L'énergie des vagues
Fonctionnement des technologies
Le principe des dispositifs capables de tirer profit des vagues consiste globalement à capter la puissance des mouvements verticaux ou latéraux de l'eau. Par exemple, les convertisseurs à colonne d'eau oscillante utilisent l'air emprisonné dans une cavité sous-marine. Quand une vague arrive, le niveau d'eau monte, chasse l'air vers le haut et entraîne une turbine Wells – spéciale car capable de tourner toujours dans le même sens, peu importe la direction du flux d'air. On voit aussi des systèmes dits "absorbeurs ponctuels" : de grosses bouées flottantes attachées à des câbles reliés à un convertisseur hydraulique ou mécanique. Lorsque la bouée monte ou descend avec le mouvement des vagues, elle génère une pression mécanique qui actionne une turbine pour produire du courant.
D'autres dispositifs, dits "serpents de mer", comme le Pelamis, ressemblent à de longs cylindres articulés posés à la surface. Les articulations entre ces cylindres se contractent et se détendent sous l'action des vagues. Ce mouvement entraîne un fluide sous pression dans un circuit hydraulique interne et active ensuite un générateur électrique.
Le rendement de ces systèmes varie beaucoup : certains atteignent entre 30 % et 40 %, selon les conditions des sites. La clé reste l'adaptabilité des équipements aux spécificités locales (hauteur des vagues, fréquence, profondeur) pour obtenir un rendement optimal. Les nouveaux convertisseurs hybrides, couplant plusieurs méthodes ensemble, montrent pas mal de potentiel en permettant une meilleure exploitation des conditions marines, même dans les zones à houle variable.
Potentiel exploitable
Au niveau mondial, on estime que le potentiel exploitable de l'énergie des vagues représente entre 2 000 et 4 000 TWh par an. Ça équivaut à peu près à la consommation annuelle actuelle d'électricité de l'Union Européenne tout entière, donc c'est loin d'être négligeable. La côte atlantique européenne, notamment au large du Portugal et de l'Écosse, est particulièrement bien servie : ces zones enregistrent régulièrement des vagues de 2 à 3 mètres de hauteur moyenne annuelle, ce qui est optimal pour la récupération énergétique.
Au niveau local, en France, la façade ouest possède un vrai trésor inexploité. Les côtes de Bretagne et du Pays basque cumulent à elles seules un potentiel technique exploitable d'environ 10 à 15 GW selon les estimations les plus récentes. C'est suffisant pour alimenter plusieurs millions de foyers français.
Le meilleur avantage, c'est que cette ressource est globalement très régulière et prévisible, ce qui facilite l'intégration à long terme dans les systèmes électriques régionaux. Pas besoin de galérer avec des systèmes de stockage aussi compliqués que pour le solaire ou l'éolien : les prévisions météo marines sont précises et permettent une bonne gestion de la production électrique.
Enfin, des pays comme l'Australie, le Chili et la Nouvelle-Zélande disposent aussi de côtes particulièrement favorables à la collecte de l'énergie des vagues, avec un potentiel impressionnant ce qui leur permettrait théoriquement de couvrir une part considérable de leurs besoins énergétiques sans émissions de gaz à effet de serre.
| Type d'énergie | Potentiel de production mondial | Avantages |
|---|---|---|
| Énergie des vagues | 1 000-10 000 TWh/an | Faible émission de CO2, prédictibilité élevée |
| Énergie marémotrice | 80-800 TWh/an | Impact visuel réduit, grande prédictibilité |
| Énergie thermique des mers | 10-100 TWh/an | Potentiel élevé dans les régions tropicales, pas d'émissions directes |
| Énergie houlomotrice | 2 500 TWh/an | Disponibilité élevée, impact visuel limité |
L'énergie marémotrice
Principes de base
L'énergie marémotrice exploite les mouvements réguliers de l'eau causés par la force gravitationnelle du soleil et surtout de la lune. Pour faire simple, on capte cette énergie grâce à deux principes : soit avec des barrages marémoteurs, soit via des courants sous-marins en pleine mer avec des hydroliennes. Les barrages retiennent l'eau montante à marée haute dans un bassin, puis libèrent cette eau à marée basse, en passant par des turbines qui produisent de l'électricité. Les hydroliennes, elles, ressemblent à des éoliennes sous-marines, et profitent directement de la vitesse des courants pour générer du courant électrique. La quantité d'énergie potentielle dépend des coefficients de marée, de l'amplitude (écart de hauteur entre marée haute et marée basse) et de la configuration des côtes (certaines baies amplifient naturellement l'effet des vagues et courants). En général, la différence de hauteur optimale pour un barrage marémoteur est d'au moins 5 mètres. Et pour faire tourner efficacement une hydrolienne, il faut que les courants dépassent régulièrement 1,5 mètre par seconde (soit environ 5,4 km/h). Le gros avantage par rapport au solaire ou à l'éolien ? La prédictibilité : les marées suivent des cycles réguliers (environ 12 heures 25 minutes entre deux marées hautes), permettant aux producteurs d'anticiper précisément l'énergie disponible.
Technologies actuelles et émergentes
Aujourd'hui, les principales solutions utilisées concrètement reposent sur deux approches assez costaudes : soit des barrages marémoteurs, soit des hydroliennes. Côté barrages marémoteurs, on connaît tous l'exemple français de La Rance en Bretagne, une centrale vieille mais toujours robuste qui peut fournir jusqu'à 240 MW avec ses turbines exploitant les entrées et sorties d'eau. Une autre solution plus récente, ce sont les hydroliennes immergées qui ressemblent à des grosses hélices sous-marines : c'est le cas avec la technologie utilisée en Écosse dans le détroit de Pentland Firth, où la centrale hydrolienne MeyGen fournit déjà à peu près 6 MW, avec un objectif ambitieux fixé à 398 MW grâce à de futures extensions.
Mais dans l'innovation pure, d'autres technos émergent avec un potentiel intéressant. Par exemple, des systèmes marémoteurs dits « flottants », équipés de turbines suspendues à des plateformes habitées ou pas, ancrées au fond marin par des câbles. Il y a aussi des entreprises qui bossent sur l'approche « cerf-volant sous-marin », comme la société suédoise Minesto, dont la techno Deep Green generate l'électricité grâce à des petits appareils flottants en forme de kite sous-marin. Ces « kites » profitent de courants faibles en effectuant des mouvements en forme de 8 pour accélérer artificiellement la vitesse de l'eau avant d'actionner une turbine intégrée et du coup produire de l'énergie même dans des courants calmes.
Enfin, côté stockage, on bosse de plus en plus sérieusement sur des solutions de stockage d'énergie par air comprimé sous-marin, permettant de couvrir les périodes de faible génération pour assurer une production régulière. C'est une piste séduisante mais elle reste expérimentale à l'heure actuelle.
Études de cas réussies
L'une des installations les plus marquantes en énergie marémotrice se situe à La Rance en France. Construite dans les années 60, elle continue aujourd'hui d'alimenter près de 225 000 foyers chaque année grâce à sa puissance installée de 240 mégawatts. Un bel exemple de projet qui dure dans le temps !
Côté Royaume-Uni, le projet MeyGen en Écosse fait figure de modèle : planté dans les eaux agitées du Pentland Firth, entre le continent écossais et les Orcades, c'est aujourd'hui la plus grande ferme hydrolienne commerciale en activité. Ses turbines sous-marines génèrent déjà plus de 30 gigawattheures d'électricité par an, allant au-delà des estimations de départ.
Au large de la Corée du Sud, la centrale marémotrice du lac Sihwa mérite le détour : inaugurée en 2011, elle possède une puissance de 254 MW, ce qui en fait l'installation marémotrice la plus puissante au monde actuellement en service. Elle produit environ 552 GWh d'électricité chaque année.
Enfin, direction le Canada avec la baie de Fundy. Dotée des marées les plus hautes au monde, atteignant parfois plus de 16 mètres de différence de hauteur d'eau, c'est là qu'a été installé le démonstrateur FORCE (Fundy Ocean Research Centre for Energy). Différentes entreprises testent sur ce site leurs technologies innovantes d'hydroliennes et enregistrent souvent des performances encourageantes, annonçant un avenir prometteur pour l'énergie marémotrice dans cette région.


10
milliards
Le nombre de dollars qui pourrait être économisé chaque année grâce à la régénération des récifs coralliens
Dates clés
-
1966
Inauguration de l'usine marémotrice de la Rance en France, première centrale marémotrice à grande échelle.
-
2000
Installation du prototype 'Pelamis', premier dispositif commercial d'énergie houlomotrice testé en Écosse.
-
2011
Déploiement réussi du parc hydrolien de SeaGen au large de l'Irlande du Nord, alors plus grande centrale au monde utilisant les courants sous-marins.
-
2015
Signature de l'accord de Paris sur le climat, renforçant l'engagement mondial vers l'exploitation des énergies renouvelables, dont les énergies marines.
-
2016
Installation du premier parc commercial éolien offshore flottant au monde au large du Portugal, démontrant la faisabilité technologique des énergies marines offshore.
-
2017
Mise en service d'une centrale d'énergie thermique marine de petite échelle à Hawaï, ouvrant de nouvelles perspectives pour cette filière émergente.
-
2020
La Commission européenne adopte la Stratégie de l'Union européenne sur les énergies renouvelables marines, visant à multiplier par cinq la capacité installée d'ici 2030.
-
2021
Inauguration à Brest, en Bretagne, du site d'essais de l'énergie marine renouvelable SEM-REV accessible à toutes les technologies marines renouvelables.
L'énergie thermique des mers
Exploitation de la différence de température
Quand on pense énergie thermique des mers, on parle surtout du système OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). L'idée, c'est simple : utiliser la différence de température entre l'eau en surface (environ 25-30°C à proximité de l'équateur) et l'eau froide des profondeurs (autour de 5°C, voire moins) pour générer de l'électricité.
Ça marche comment concrètement ? Tu as deux grandes techniques :
La première méthode, en cycle fermé, utilise un fluide avec un faible point d'ébullition (typiquement de l'ammoniac). Tu prends l'eau chaude de surface pour faire évaporer ce fluide et ainsi entraîner une turbine qui produit de l'électricité. Derrière ça, tu refroidis et condenses ce fluide avec l'eau froide des profondeurs, et le cycle recommence. Pas sorcier.
Deuxième option, le cycle ouvert : ici, l'eau chaude est directement aspirée en surface pour être mise sous vide, ce qui provoque une évaporation rapide. La vapeur obtenue fait tourner une turbine. À la fin du circuit, on récupère l'eau condensée, extrêmement pure au passage (bonus intéressant : tu récupères carrément de l'eau potable).
Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'installations fonctionnelles, mais on peut citer par exemple le projet OTEC de Kumejima au Japon ou celui de Hawaï (Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority), qui bossent activement sur des installations pilotes à petite échelle.
Le truc important à savoir : pour que ça marche bien, il faut une différence thermique d'au moins 20°C entre les couches d'eau chaude et froide. Ce critère limite naturellement les zones exploitables, principalement autour de l'équateur, dans les océans tropicaux ou subtropicaux.
Côté rendement énergétique, soyons honnêtes, c'est pas exceptionnel (environ 3 à 5%). Mais attention, là où c'est malin, c'est que la ressource (l'océan, donc) est énorme, constante et accessible quasiment 24h/24, contrairement au solaire ou à l'éolien. De ce côté-là, OTEC a un avantage énorme au niveau stabilité.
Autre bonus sympa : en plus de produire de l'électricité et de l'eau potable, certains projets combinent OTEC avec l'aquaculture ou la climatisation des bâtiments proches (refroidissement naturel via eau froide profonde). Un exemple ? À Bora Bora, un hôtel utilise justement ce système pour climatiser ses chambres tout en réduisant considérablement sa facture d'énergie.
Alors oui, il reste quelques obstacles techniques et économiques, mais globalement, OTEC mérite largement qu'on s'y intéresse de près, surtout dans un monde en recherche constante de solutions énergétiques durables.
Potentiel de développement et limites géographiques
L'énergie thermique des mers (ETM), c'est surtout intéressant dans les zones tropicales, là où les écarts de température entre la surface et les eaux profondes sont marqués (autour de 20°C minimum nécessaires). Concrètement, ça limite le potentiel géographique à des régions bien spécifiques, notamment aux alentours de l'équateur, comme aux Antilles, en Polynésie française, dans l'océan Indien ou encore au large de certaines zones côtières d'Asie-Pacifique.
Le potentiel mondial en puissance nette est estimé autour de 7 terawatts (TW), ce qui est assez énorme sachant que la consommation mondiale d'électricité tourne généralement autour de 2 à 3 TW en moyenne. Mais attention, installer une centrale ETM, c'est assez gourmand en infrastructures, en investissement et en maintenance. On ne peut donc pas exploiter ce potentiel partout facilement.
Puis, il y a aussi la réalité du terrain : les forts courants marins, les tempêtes fréquentes dans certaines régions tropicales, comme les ouragans dans les Caraïbes, rendent les installations costaudes et plus coûteuses. Les profondeurs nécessaires (800 à 1 000 mètres minimum pour puiser l'eau froide) compliquent davantage les things. Ça suppose des environnements marins particuliers, proches de côtes présentant rapidement ces grandes profondeurs. C'est faisable, mais ça restreint sérieusement les lieux propices.
De plus, des analyses récentes montrent que même si l'ETM se développe progressivement, les coûts restent encore élevés aujourd'hui (on parle couramment d'un coût de production entre 150 à 350 euros le MWh), ce qui ralentit nettement son intégration massive dans les réseaux électriques.
Bref, l'énergie thermique des mers est très prometteuse, surtout dans quelques spots bien choisis, mais sa généralisation devra encore attendre des avancées technologiques et économiques significatives.
Le saviez-vous ?
Contrairement aux panneaux solaires ou aux centrales éoliennes intermittentes, certaines technologies marines, comme l'énergie marémotrice, sont très prévisibles : les marées peuvent être anticipées longtemps à l'avance avec une grande précision, simplifiant ainsi l'intégration dans les réseaux électriques existants.
Le potentiel théorique mondial des énergies marines renouvelables est estimé entre 20 000 et 90 000 TWh par an, soit beaucoup plus que la consommation annuelle d'électricité au niveau mondial, qui était estimée à environ 28 000 TWh en 2021.
La première usine marémotrice au monde, celle de la Rance en Bretagne (France), mise en service en 1966, génère aujourd'hui environ 500 GWh par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle en électricité d'environ 225 000 habitants.
L'énergie thermique des mers (ETM) repose sur l'exploitation du différentiel de température entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des profondeurs. En règle générale, une différence d'au moins 20°C est nécessaire pour assurer un rendement efficace de ces installations.
L'énergie houlomotrice
Technologies utilisées
Les dispositifs houlomoteurs les plus efficaces aujourd'hui marchent sur quelques principes simples mais astucieux. Les Pelamis, par exemple, ressemblent à ces serpents géants flottants qui suivent le mouvement des vagues : des vérins hydrauliques entre les segments transforment chaque ondulation en énergie électrique. L'avantage ? Ça marche même dans des conditions de mer agitée.
Ensuite, t'as le système Oscillating Water Column (OWC), ou colonne d'eau oscillante. Imagine une grande chambre partiellement immergée ouverte sur la mer, avec de l'air piégé à l'intérieur. Quand les vagues arrivent, elles font varier le niveau d'eau, ce qui comprime et décomprime l'air au-dessus. Résultat : un flux qui actionne une turbine spéciale, comme la turbine Wells, capable de tourner toujours dans le même sens, quel que soit le sens du flux d'air. Plutôt malin, ce truc-là.
Y a aussi le concept des absorbeurs ponctuels, sorte de grosses bouées ancrées au fond marin. La vague les fait monter et descendre, ce mouvement relatif active un générateur à l'intérieur direct. Ce système est particulièrement intéressant car il peut être facilement utilisé en réseau, groupant plein de bouées pour augmenter le rendement total.
Enfin, un modèle à connaître, c'est le Wave Dragon (« dragon des vagues »). Son approche diffère un peu : c'est une large plateforme flottante qui collecte et concentre l'eau poussée par les vagues dans un réservoir situé plus haut. L'eau stockée s'écoule ensuite à travers des turbines hydrauliques pour produire de l'électricité en continu.
Chacune de ces technologies possède ses propres avantages et défis, mais toutes partagent la même idée : capter efficacement le mouvement naturel des océans pour faire tourner nos ampoules.
Impact environnemental
Les installations houlomotrices, c'est généralement plutôt écologique comme idée, mais attention, tout n'est pas neutre non plus. Par exemple, les dispositifs comme les Pelamis ou les bouées ancrées au large peuvent modifier les courants locaux et l'érosion du fond marin. Résultat : les habitats des poissons ou autres animaux peuvent bouger, ce qui peut dérégler leur rythme de vie.
Un autre truc pas évident, c'est le bruit sous-marin. Oui, ces installations émettent souvent un bruit continu à basse fréquence qui dérange notamment les mammifères marins (comme les baleines ou les dauphins). Ces animaux communiquent et s'orientent grâce au son, du coup ça peut être problématique pour leur reproduction ou leur recherche de nourriture.
Autre problème à ne pas zapper : l'utilisation d'équipements métalliques favorise parfois la corrosion. Et là, tu peux avoir des relargages de matériaux dans l'eau, surtout dans les premières années d'exploitation. Des études montrent même que certains traitements anticorrosion rejettent des métaux lourds toxiques comme le zinc ou le cuivre dans l'eau marine. Pas terrible.
Bon, côté positif (car oui, il y en a aussi !) : certaines structures houlomotrices immergées peuvent vite devenir des récifs artificiels et abriter plus de biodiversité marine. On parle alors d'effet récif artificiel. Ça attire des poissons, des crustacés, puis d'autres prédateurs plus grands. Plutôt sympa, non ? Mais attention, ça dépend du matériau utilisé et du type d'installation, donc c'est pas toujours automatique !
Énergie des courants sous-marins
Méthodes d'extraction de l'énergie
Les turbines sous-marines constituent la méthode phare : elles utilisent des hélices semblables à celles des éoliennes, mais placées sous l'eau. Immergées dans des courants stratégiques, elles convertissent naturellement l'énergie cinétique des courants marins puissants en électricité. Certaines, comme celles du projet MeyGen en Écosse, produisent jusqu'à 1,5 mégawatt par turbine—rien que ça. D'autres techniques plus inattendues existent également, par exemple les hydroliennes à oscillation. Ces dernières se balancent sous l'eau comme les nageoires d'un poisson pour générer l'électricité grâce à leurs mouvements mécaniques. Autre approche, le principe du cerf-volant sous-marin. L'entreprise suédoise Minesto expérimente une aile sous-marine reliée au fond marin par un câble flexible. Elle effectue des boucles en forme de huit, augmentant ainsi considérablement la vitesse de rotation de ses turbines internes : malin et ultra prometteur quand les courants sont moins rapides. Enfin, certaines méthodes utilisent des canaux artificiels ou des barrages de marée, destinés à capter l'eau en mouvement dans des endroits où la topographie du littoral s'y prête, comme à la centrale de la Rance en Bretagne, exploitée efficacement depuis plus de 50 ans.
Sites prometteurs à l'échelle mondiale
En matière de courants sous-marins, certains spots font déjà rêver les ingénieurs et investisseurs. Parmi eux, le Raz Blanchard en France, situé au large du Cotentin, là où les courants atteignent parfois les 5 mètres par seconde (ça décoiffe sous l'eau, crois-moi). Son potentiel théorique pourrait couvrir une partie significative des besoins en électricité de la Normandie. Pas mal, non ?
Outre-Manche, le détroit du Pentland Firth, en Écosse, est un incontournable. Cet endroit concentre près de 50 % du potentiel européen pour les courants sous-marins. Les Britanniques y testent déjà des turbines gigantesques pour capter toute cette énergie.
Et puis direction l'Amérique du Nord : la baie de Fundy, entre le Canada et les États-Unis. Connue pour ses marées records, avec jusqu'à 16 mètres de différence entre marée haute et basse, elle représente l'un des gisements énergétiques marins les plus exceptionnellement puissants au monde.
On pense aussi au Japon avec le détroit de Naruto, célèbre autant pour ses tourbillons spectaculaires que pour ses courants ultra-rapides. Avec une vitesse atteignant parfois 20 km/h, on parle là d'un sacré potentiel énergétique pour l'archipel nippon.
Enfin, plus au Sud, il y a le canal entre Bali et Lombok en Indonésie, traversé par un courant marin stable et puissant venu du Pacifique vers l'océan Indien. Celui-ci est désormais clairement sur les radars comme futur gisement d'énergie renouvelable pour alimenter des milliers d’habitants.
Les enjeux environnementaux et sociaux
Conservation de la faune marine
Risques et mesures de mitigation
L'installation des turbines marémotrices et des convertisseurs d'énergie marine peut perturber les trajets migratoires des animaux marins comme les baleines, les phoques ou certains poissons. Un cas concret, c'est le parc hydrolien de MeyGen en Écosse : pour éviter les collisions avec les mammifères marins, ils utilisent des dispositifs de surveillance acoustique sous-marine (hydrophones) pour détecter leur présence instantanément. Dès qu'un animal s'approche trop près, ils diminuent la vitesse de rotation des turbines ou les arrêtent carrément temporairement.
Même chose avec le bruit lié au fonctionnement des installations — ça peut franchement perturber la communication des mammifères marins. La solution pratique ? Installer des systèmes de réduction acoustique dès la conception ou choisir des emplacements stratégiques, loin de zones sensibles pour la faune. Au projet Sabella dans les courants marins bretons, les turbines sont spécialement conçues pour limiter leur bruit sous-marin et minimiser l'impact acoustique sur les dauphins et autres mammifères présents autour d'Ouessant.
Puis t'as les câbles électriques sous-marins qui peuvent influencer les requins et raies, lesquels utilisent les champs électromagnétiques naturels pour s'orienter et chasser. Pour ça, les gestionnaires de parc doivent prévoir l'enfouissement des câbles sous le fond marin, ou encore les envelopper totalement dans des gaines spéciales pour limiter le champ électromagnétique dégagé.
Autre point important, certains dispositifs mobiles ou flottants peuvent dégrader les fonds marins par abrasion ou ancrages répétés. La pratique à suivre : faire une véritable étude écologique préalable pour identifier exactement les zones les plus fragiles, ménager des corridors écologiques et éviter les sites riches en coraux ou en herbiers marins remarquables. Une façon pragmatique et simple de combiner énergies marines et préservation écologique.
Concertation avec les communautés locales
C'est souvent sur le terrain que se joue l'avenir d'un projet d'énergie marine. Si les locaux ne sont pas associés aux décisions dès le début, même un projet hyper prometteur peut capoter. Un exemple concret, c'est celui du Parc hydrolien de la baie de Fundy au Canada : les communautés locales ont été impliquées dès la phase initiale. Des ateliers réguliers organisés avec les pêcheurs et les résidents ont permis d'évaluer ensemble l'emplacement optimal des turbines sous-marines, limitant ainsi l'impact sur l'activité de pêche traditionnelle.
Les démarches participatives, comme les ateliers "World Café" ou les comités consultatifs citoyens, donnent une vraie voix aux communautés côtières concernées. Ces rencontres permettent d'aborder de front les inquiétudes sur le bruit sous-marin, l'accès aux zones de pêche ou encore l'impact paysager des installations.
Côté France, on peut citer l'exemple du projet SEM-REV, près du Croisic. Là-bas, l'Université de Nantes a mis l'accent sur le dialogue permanent avec les habitants. Résultat, le projet a évolué en fonction des retours, avec une implantation optimisée des câbles sous-marins pour éviter les zones de biodiversité sensible.
Bref, une concertation ouverte avec les communautés locales, c'est pas juste du bonus éthique : c'est essentiel au succès concret des énergies marines renouvelables.
500 GWh
La production potentielle d'électricité à partir de l'énergie des vagues dans le monde
1.8 GW
La capacité techniquement exploitable de l'énergie houlomotrice en Europe
27 %
La part de la production d'électricité en France provenant des énergies renouvelables en 2020
80 %
Estimation du pourcentage de la puissance hydrolienne mondiale qui pourrait être installée au Royaume-Uni, pionnier en la matière
500 milliards d'€
Le montant des investissements dans la transition énergétique et écologique pour la période 2019-2028 en France
| Type d'énergie marine | Potentiel global | État de développement |
|---|---|---|
| Énergie marémotrice | 1 TW | Commerciale |
| Énergie houlomotrice | 80 TW | Prototype/Démonstration |
| Énergie thermique des mers | 88 000 TWh/an | Prototype/Démonstration |
| Énergie des courants marins | Non quantifié précisément | Recherche et Développement |
Cadre réglementaire et politiques publiques
Réglementation internationale et européenne
Au niveau international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) joue un rôle essentiel, en particulier pour l'installation d'infrastructures en mer. Elle impose que toute activité offshore respecte la protection de l'environnement marin, ce qui inclut clairement les énergies marines renouvelables. En Europe, c'est surtout la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) qui donne le ton. Elle encourage aussi bien le développement des énergies marines qu'un suivi renforcé des impacts sur les écosystèmes.
À côté de ça, chaque projet en Europe doit passer par une évaluation environnementale approfondie grâce à la Directive Européenne sur l'Évaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE). Concrètement, ça signifie que toute installation, même expérimentale, doit être soigneusement examinée avant de voir le jour.
En pratique, ça rend le lancement d'un projet souvent long et complexe, ok, mais ça garantit aussi qu'on ne fait pas n'importe quoi avec nos magnifiques côtes et océans. Côté positif aussi : depuis 2021, la Commission Européenne a annoncé sa stratégie pour les énergies marines, avec à la clé des objectifs clairs et ambitieux, comme atteindre 60 GW de capacité installée en énergies océaniques (vagues, marées, courants) d'ici 2050. Ça montre bien que les énergies marines montent en puissance dans le paysage énergétique européen.
Politiques de soutien et d'incitation
Aujourd'hui les États jouent un rôle de facilitateur concret dans le développement des énergies marines renouvelables. Prenons l'exemple de la France, qui prévoit un tarif d'achat garanti pour l'électricité issue des projets marins afin de rassurer les investisseurs sur la rentabilité à long terme. Même stratégie au Royaume-Uni, avec les Contracts for Difference (CfD), un mécanisme qui sécurise les revenus des producteurs marins en compensant les écarts entre le prix de marché et un tarif prédéfini. Petit plus concret : l'Écosse a mis en place un système de zonage marin clair qui facilite vraiment les démarches des porteurs de projet.
Autre approche sympa : certains pays ont choisi de financer directement les phases de recherche et de test. Le Portugal, par exemple, supporte activement le centre d'expérimentation Wave Energy Centre à Pico, un point fort pour les startups innovantes. Idem pour le Danemark, qui via l'agence publique EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Program) finance directement des prototypes marins innovants.
Le côté incitatif fiscal aussi, ça marche fort. L'Irlande propose depuis plusieurs années des crédits d’impôt spécifiques aux entreprises qui investissent dans les énergies marines, concrètement ça réduit leurs coûts initiaux et c'est bon pour tout le monde.
Enfin, petit scoop intéressant, au-delà du soutien financier direct, des programmes européens spécifiques comme Horizon Europe et BlueInvest accompagnent techniquement et financièrement des projets innovants en énergies marines : conseils, réseautage, accompagnement sur-mesure. Une manière réelle de booster une filière encore jeune mais prometteuse.
Potentiel et limitations géographiques
Zones à fort potentiel mondial
Dans certains coins du globe, les mers sont tellement puissantes que ça rendrait jaloux n'importe quel producteur d'énergie verte. Par exemple, le détroit de Pentland Firth, en Écosse, c'est un peu l'autoroute des courants marins, avec des vitesses atteignant jusqu'à 5 mètres par seconde : énorme potentiel pour l'énergie marémotrice ! De son côté, la baie de Fundy au Canada renferme des marées records contrastant parfois de plus de 16 mètres. De quoi produire énormément d'électricité régulièrement.
Si on file vers le Chili, la côte Pacifique est particulièrement costaud niveau vagues, surtout la zone à proximité de Valdivia où les vagues atteignent régulièrement 3 mètres de haut, idéal pour des installations houlomotrices de grosse capacité. Pareil côté australien, avec la côte ouest près de Perth qui offre souvent des vagues puissantes très régulières.
Dans les régions tropicales, comme à Hawaï ou dans les Caraïbes, c'est plutôt l'énergie thermique des mers qui cartonne grâce aux différences températures eau chaude de surface / eau froide des profondeurs dépassant souvent les 20°C, condition parfaite pour ce type d'installation qui exploite justement ce contraste thermique.
Au Japon, le courant marin Kuroshio est une vraie mine d'or énergétique. Ce courant, une sorte de Gulf Stream local, est stable, rapide, et pourrait générer jusqu'à 200 gigawatts selon certaines estimations—plusieurs fois de quoi alimenter tout Tokyo !
Même scénario prometteur du côté français avec le raz Blanchard en Normandie. Là-bas, les courants atteignent une vitesse moyenne de 3 à 4 mètres par seconde. Ce spot est d’ailleurs ciblé officiellement par les pouvoirs publics français pour accélérer le développement de l'énergie hydrolienne.
Contraintes géographiques et météorologiques
D'abord, parlons de la profondeur des fonds marins. Beaucoup de technologies nécessitent des installations à faible profondeur, typiquement entre 20 et 50 mètres. Or, près de 90 % de l'énergie potentiellement exploitable se trouve au large, dans les zones profondes, souvent supérieures à 100 mètres.
Ensuite, il y a la question de la distance aux côtes. Les meilleurs sites en matière de potentiel énergétique se trouvent souvent loin des infrastructures électriques existantes. Résultat : tirer des câbles sous-marins devient complexe et coûteux.
Autre souci concret : les conditions météo extrêmes. Les tempêtes, par exemple, frappent fort l'Atlantique nord, avec des vagues pouvant dépasser les 20 mètres facilement. Ce genre de conditions extrêmes met à rude épreuve les installations, ralentit leur entretien et augmente sensiblement les coûts.
On oublie souvent la variabilité saisonnière. Par exemple, aux latitudes élevées, les marées peuvent présenter de grosses différences d'amplitude entre hiver et été, ce qui implique que la production n'est pas constante, contrairement au mythe souvent véhiculé.
Enfin, certaines zones géographiques sont confrontées à des aléas géologiques. Les régions exposées aux séismes ou aux tsunamis nécessitent des dispositifs de sécurité plus solides et adaptés, comme au large du Japon ou en Indonésie. Une contrainte que chaque développeur doit anticiper sérieusement.
Les opportunités économiques des énergies marines
Création d'emplois directs et indirects
Développer les énergies marines, ça crée concrètement des métiers directs super polyvalents : techniciens spécialisés, ingénieurs océaniques, plongeurs professionnels pour les maintenances sous-marines, ou encore opérateurs de salles de contrôle pour surveiller les installations. Par exemple, le parc hydrolien de MeyGen, au nord de l'Écosse, c'est environ 120 emplois directs locaux rien que dans sa première phase de déploiement.
Autour de ça, énormément d'activités indirectes voient le jour aussi : construction navale spécialisée pour les navires de service, entreprises logistiques pour transporter les équipements, ou encore bureaux d'études techniques pour la supervision environnementale. À Brest, France Énergies Marines (FEM), centre de recherche dédié aux énergies océaniques, fait travailler aujourd'hui près de 80 chercheurs et experts techniques, avec tout un écosystème régional de PME mobilisées sur différents projets.
Plus loin en amont, ça fait aussi travailler des usines d'acier ou des ateliers mécaniques pour la production des pièces. En aval, il y a évidemment toutes les activités administratives ou les sous-traitances pour le suivi de l'environnement marin.
D'après certaines études économiques de l'Union Européenne, chaque mégawatt (MW) installé dans l'énergie marine peut générer entre 10 et 20 emplois à temps plein. Du coup, si les gouvernements et les entreprises jouent le jeu niveau investissements, c’est toute une filière économique qui se développe autour du territoire marin.
Développement régional et local
Le développement des projets d'énergies marines, comme les parcs hydrolien ou houlomoteurs, donne souvent un vrai coup de boost localement. Tu prends la région de Cherbourg par exemple : avec l'implantation de l'usine LM Wind Power dédiée à la fabrication de pales pour éoliennes offshore, plus de 500 emplois directs ont été créés, auxquels s'ajoutent des centaines de postes indirects auprès de sous-traitants locaux et commerces environnants.
Même scénario dans la zone autour de Saint-Nazaire : l'essor des installations liées aux énergies marines y a généré environ 1 000 emplois stables, allant des techniciens en maintenance aux ingénieurs spécialisés ou techniciens de port.
L'installation de ces infrastructures attire de nouvelles formations professionnelles spécifiques, souvent en partenariat avec les universités ou instituts techniques de la région. Ça permet aux jeunes locaux d'avoir accès à des carrières intéressantes sur place, sans devoir aller s'exiler ailleurs.
Autre effet concret : les ports régionaux retrouvent souvent une seconde jeunesse. Par exemple, Brest accueille aujourd'hui des entreprises spécialisées dans l'assemblage et la maintenance d'éoliennes flottantes (Plateforme du port de commerce et du polder dédiée aux EMR). Plutôt malin quand on sait que ces nouvelles activités viennent compenser en partie le déclin de la pêche ou de la construction navale traditionnelle.
Ces filières renforcent aussi les savoir-faire locaux et leur reconnaissance plus large. Les entreprises locales se retrouvent boostées, les hôtels et restaurants profitent du flux supplémentaire de techniciens et d'ingénieurs, et les municipalités voient les recettes fiscales grimper grâce aux installations industrielles et infrastructures associées.
Bref, l'essor des énergies marines renouvelables apporte plus que de la simple électricité verte : il revitalise concrètement et durablement des territoires parfois délaissés économiquement depuis longtemps.
Foire aux questions (FAQ)
Les coûts varient fortement en fonction des technologies utilisées, mais ont tendance à diminuer à mesure que celles-ci se développent. Aujourd'hui, certaines technologies marines restent plus coûteuses que l'éolien ou le solaire, mais leur potentiel de baisse des coûts est significatif à moyen-long terme, à condition d'investissements suffisants et continus.
Le potentiel mondial est considérable, bien qu'encore largement inexploité. Selon certaines estimations, l'énergie marine pourrait couvrir une proportion significative des besoins énergétiques mondiaux, particulièrement dans les régions côtières à fortes marées ou à grande activité des vagues. Elle représente un complément intéressant aux autres énergies renouvelables, pouvant fournir une production plus prédictible que le solaire ou l'éolien.
Oui, dans la mesure où des études d'impacts environnementaux sont réalisées et où les technologies sont correctement choisies et optimisées. Cependant, comme toute infrastructure, certaines technologies peuvent avoir des effets sur les habitats et les espèces marines, nécessitant des mesures adaptées pour atténuer ces impacts.
Les principales formes incluent l'énergie marémotrice, l'énergie des vagues (houlomotrice), l'énergie thermique des mers et l'énergie des courants sous-marins. Chacune de ces sources exploite différentes caractéristiques de l'environnement marin pour produire de l'électricité renouvelable.
Oui, la France possède plusieurs installations marines opérationnelles ou expérimentales. Par exemple, l’usine marémotrice de la Rance en Bretagne, mise en service en 1966, reste un exemple mondial pionnier dans l'exploitation de l'énergie marémotrice. De nombreux autres projets, notamment en Normandie et en Bretagne, sont en cours de développement ou d'évaluation pour exploiter d'autres formes d’énergies marines renouvelables.
Le secteur des énergies marines pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects, tels que des ingénieurs spécialisés en énergie marine, des techniciens pour la maintenance des équipements, des chercheurs et des experts en environnement maritime, ainsi que des emplois liés à la construction, à la logistique et aux services annexes aux projets énergétiques.
Cela dépend de la forme d'énergie marine considérée. Les énergies marémotrice et des courants marins offrent une production très prévisible et régulière. À l'inverse, l'énergie des vagues, tout en étant très abondante, peut être plus variable dans le temps. Néanmoins, une combinaison judicieuse des différents types d'énergies marines peut contribuer à une production énergétique stable et fiable.
Les défis principaux comprennent des coûts élevés encore associés à certaines technologies, une complexité technique dans des environnements marins souvent hostiles, des régulations strictes et nécessaires pour protéger l'environnement marin, ainsi qu'une intégration nécessaire mais complexe dans les réseaux électriques existants.
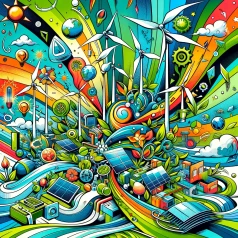
Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)
Quizz
Question 1/5
