Introduction
L'avenir énergétique, on en parle partout, mais quand on pense renouvelable, on cite souvent le solaire ou les champs d’éoliennes. Pourtant, il suffit parfois de regarder vers la mer pour comprendre que les vagues et les marées cachent elles aussi un incroyable potentiel de production d'énergie. Ça tombe bien : avec plus de 70 % de la surface terrestre recouverte par les océans, on a face à nous une vraie source d'énergie, renouvelable et prévisible. C'est là que l'énergie marémotrice entre en jeu.
En clair, l'énergie marémotrice, c’est simplement l'énergie produite grâce aux mouvements réguliers des marées. Pas de vent qui s'arrête soudainement ni de soleil qui disparaît derrière une couche de nuages. Les marées, elles, suivent leur rythme, réglées comme du papier à musique par la lune et le soleil. Cette régularité rend justement l'énergie marémotrice particulièrement fiable et facile à planifier.
En plus, sur le papier, son potentiel est énorme. Certains estiment même que, bien exploitée, l'énergie marémotrice pourrait fournir une part significative de nos besoins énergétiques mondiaux. Une excellente nouvelle dans un contexte où réduire les émissions de gaz à effet de serre devient urgentissime. D'autant que, comparée aux énergies fossiles, elle affiche une empreinte carbone extrêmement réduite.
Mais alors pourquoi n'investit-on pas davantage dans cette source d'énergie apparemment géniale ? Eh bien parce que, forcément, tout n'est pas rose (ou bleu océan). L'exploitation marémotrice amène aussi son lot de difficultés techniques, environnementales et sociales. Entre les défis techniques complexes, les coûts de départ plutôt importants et les questions autour de l’impact sur les écosystèmes marins, il reste encore du boulot avant que les moteurs de la planète tournent essentiellement grâce à l'océan.
Dans cette page, on va défricher ensemble les opportunités concrètes qu'offre l'énergie marémotrice pour une transition durable à grande échelle. On fera un tour rapide des technologies existantes, des réalisations pratiques qui marchent déjà autour du globe, mais aussi des freins et défis que doit relever cette filière prometteuse. Allez, plongeons direct dans le sujet.
78%
La part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'électricité en Islande en 2019
8 Md $
Les investissements mondiaux dans l'énergie marine (y compris la marémotrice) en 2020
240MW
La capacité totale d'énergie marémotrice installée dans le monde en 2021
6 500 heures
Le nombre d'heures annuelles moyennes de production des barrages marémoteurs en France
Qu'est-ce que l'énergie marémotrice?
Origine et principes fondamentaux de l'énergie marémotrice
Les marées viennent surtout de l'attraction gravitationnelle exercée par la Lune, mais aussi en partie par celle du Soleil. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la distance Terre-Lune joue un rôle bien plus important que la taille même de l'astre : la Lune, beaucoup plus proche de nous (environ 384 400 km), a à peu près deux fois plus d'effet sur les marées que le Soleil, pourtant nettement plus massif mais très éloigné (environ 150 millions de km).
Lors des périodes de pleine lune et de nouvelle lune, Lune et Soleil s'alignent avec la Terre, et là, on obtient les marées de vives-eaux. C'est à ce moment qu'on atteint les amplitudes maximales de marée. À l'inverse, quand ces trois astres se trouvent en angle droit (premier et dernier quartiers de lune), l'effet solaire se soustrait un peu à celui de la Lune : on appelle ça des marées de mortes-eaux, avec des amplitudes plus faibles.
Concernant les principes physiques, pour produire de l’électricité marémotrice, on profite justement de ces variations du niveau de la mer. L'idée, c’est d'exploiter la différence de hauteur d'eau (appelée marnage) entre la marée haute et la marée basse. Plus cette différence est forte, meilleure sera la capacité à générer de l'énergie. D'ailleurs, pour que l'exploitation soit concrètement rentable, un marnage d’au moins 5 mètres est souvent nécessaire en pratique.
Il existe une autre manière de récupérer cette énergie : c’est en exploitant directement le débit des courants marins causés par les déplacements réguliers de grandes masses d'eau. Là, plus besoin d'attendre une différence de marée énorme, une vitesse de courant minimale autour de 2 à 3 mètres par seconde suffit souvent à rendre l'installation intéressante niveau production électrique.
Bref, derrière la simplicité apparente des marées quotidiennes, il y a tout un jeu complexe d'attractions célestes et de géographie locale qui crée ce formidable potentiel énergétique, renouvelable et surtout prévisible.
Types de technologies marémotrices
Les barrages marémoteurs
Bon, le principe d'un barrage marémoteur est assez direct : on bloque une baie ou un estuaire avec un barrage équipé de turbines, l'eau monte avec la marée haute, puis hop, au moment où la marée redescend, on libère l'eau accumulée, passe par les turbines, ça tourne, ça turbine, et ça produit de l'électricité. Plutôt simple et efficace.
Exemple concret à garder en tête : La centrale de la Rance, en Bretagne, inaugurée dans les années 1960, produit environ 500 GWh chaque année, de quoi éclairer une ville comme Rennes toute entière. Et c'est du très stable comme production, puisque les marées, c'est réglé comme une horloge suisse. Autre exemple un peu moins connu, la centrale Sihwa Lake en Corée du Sud, construite en 2011, produit une puissance de 254 MW, faisant d'elle actuellement la plus puissante au monde.
Par contre, petit bémol : ces gros barrages ne s’installent pas n'importe où. Il faut des amplitudes de marées importantes (idéalement plus de 5 mètres) pour que ça vaille vraiment le coup au niveau énergétique et financier. À part ça, c'est une technologie bien rodée, mais les impacts écologiques restent un souci majeur (blocage des migrations des poissons, modification sensible du milieu marin). Bref, si t'as le bon endroit et de bons moyens pour limiter l'impact écologique, c'est une solution marémotrice qui marche nickel.
Les hydroliennes à courant de marée
Les hydroliennes reposent sur un principe simple : elles utilisent les courants créés par les marées pour faire tourner des turbines sous-marines. Contrairement aux barrages marémoteurs, pas besoin de construire des digues géantes, du coup moins d'impacts directs sur l'environnement. Là où les courants atteignent environ 2 à 5 mètres par seconde (comme au large des côtes bretonnes en France ou dans le détroit d'Orkney en Écosse), ces turbines sont vraiment efficaces.
Côté concret, tu as l'exemple flagrant du projet MeyGen dans le Pentland Firth en Écosse. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes installations mondiales avec des turbines énormes installées entre 30 et 50 mètres sous la surface. À pleine capacité, ce projet vise à produire jusqu'à 398 mégawatts, soit de quoi alimenter environ 175 000 foyers écossais en électricité.
Pour tirer profit de cette technologie, les acteurs doivent identifier précisément les zones marines les plus propices (courants forts, constance dans les cycles de marée, profondeur suffisante). L'autre priorité, c'est la sélection de turbines robustes, faciles à entretenir, et surtout d'une taille raisonnable pour minimiser la gêne envers la faune marine. D'ailleurs, pour aller dans ce sens, plusieurs développeurs bossent actuellement sur des systèmes équipés de pales repliables ou encore tournant à vitesse réduite pour éviter de blesser poissons et mammifères marins.
En bref, miser sur l'énergie des courants marins avec les hydroliennes, c'est prometteur, mais ça demande une approche prudente, une planification rigoureuse et une attention permanente aux retours d'expérience existants (comme MeyGen justement).
Les lagunes marémotrices artificielles
Les lagunes marémotrices artificielles, c’est une approche plutôt originale : au lieu de construire un énorme barrage à travers une baie naturelle, on crée des réservoirs fermés en mer, séparés artificiellement par un mur. Ça permet d’exploiter les mouvements d'eau à l’intérieur sans trop toucher aux écosystèmes côtiers.
Un exemple concret : le projet "Swansea Bay" au pays de Galles. Son mur circulaire d'environ 9,5 kilomètres devait capturer la marée deux fois par jour pour générer jusqu’à 320 MW d’électricité (assez pour alimenter plus de 150 000 foyers). Le concept proposait aussi d’utiliser la structure comme espace public pour loisirs, tourisme et sport nautique—ce qui rendait le tout plus attractif pour la communauté locale.
Même si Swansea n'a pas encore vu le jour (principalement à cause des coûts élevés et des débats politiques au Royaume-Uni), ce genre de projet attire l'attention internationale grâce à son double bénéfice : génération stable d'énergie verte et création d’activités économiques locales. Pour l’avenir, d’autres projets similaires pourraient être réalisables dans des régions à très fortes marées, comme le nord-ouest de la France ou certaines côtes au Canada. Le grand avantage, c’est que ces structures isolées limitent pas mal les dégâts sur la biodiversité marine par rapport aux énormes barrages marémoteurs classiques.
Sites mondiaux propices à l'exploitation marémotrice
Quand on parle de marée puissante, on pense tout de suite à certains endroits précis sur le globe. La Baie de Fundy, située entre le Canada et les États-Unis, est tout en haut de la liste. Pourquoi ? Parce que ses marées peuvent atteindre 16 mètres de haut—de quoi produire beaucoup, beaucoup d'électricité.
Sur la côte européenne, tu as l'estuaire de la Severn au Royaume-Uni, entre le Pays de Galles et l'Angleterre. À cet endroit, la différence de niveau d'eau atteint parfois près de 14 mètres. Le potentiel est là, mais attention aux débats environnementaux locaux qui mettent souvent un frein à ces projets ambitieux.
Moins médiatisée mais extrêmement prometteuse, la région du nord-ouest de l'Australie, dans la région de Kimberley, offre aussi un potentiel énorme grâce aux puissants courants des marées, parfois à plus de 11 mètres.
Bon plan également du côté de l'Argentine, avec le golfe San José en Patagonie. Là-bas, des études récentes montrent un potentiel énergétique exploitable important grâce notamment à une amplitude de marée souvent supérieure à 9 mètres.
Pour revenir en Europe, la France ne se limite pas à la célèbre usine marémotrice de La Rance. Le raz Blanchard, situé au large du Cotentin, a été identifié par plusieurs études françaises comme l'une des zones à potentiel le plus élevé pour l'installation future d'hydroliennes, grâce aux courants marins très forts qui circulent entre le Cotentin et les îles Anglo-Normandes. Ici, le potentiel théorique dépasse les 3 GW !
Enfin, direction l'Asie du Sud-Est : les détroits entres les nombreuses îles des Philippines et d'Indonésie, comme l'étroit détroit de San-Bernardino aux Philippines, offrent des courants rapides constants particulièrement adaptés à la technologie des hydroliennes. Là-bas, la marée est plus dynamique que verticale, mais le potentiel reste excellent et largement sous-exploité.
| Avantages | Défis | Exemples de projets |
|---|---|---|
| Renouvelable et prévisible | Coûts initiaux élevés | La Rance (France) |
| Faible impact environnemental | Impact sur la faune marine | Sihwa Lake (Corée du Sud) |
| Haute densité énergétique | Technologie encore immature | MeyGen (Royaume-Uni) |
Historique du développement de l'énergie marémotrice
Premiers projets expérimentaux
Dans les années 1920, les ingénieurs se sont lancés dans les tout premiers essais sérieux pour exploiter les marées comme source d'énergie renouvelable. L'un des exemples pionniers était clairement le projet de l'estuaire de la Severn au Royaume-Uni. Dès 1925, des chercheurs ont proposé d'y installer un barrage pour capturer l’énergie des très fortes marées de la région. Ce projet n'a jamais abouti à l'époque, mais il a quand même lancé une réflexion sur la faisabilité du procédé.
Un autre cas intéressant est situé aux États-Unis en 1935. Sur la côte Est, précisément dans la baie de Passamaquoddy, à la frontière entre les États-Unis et le Canada, le président américain Franklin Roosevelt a tenté de faire construire une centrale marémotrice. Ce projet était ambitieux : il combinait le potentiel énergétique des marées et une composante de relance économique pendant la Grande Dépression. Malheureusement, faute de financement et de soutien politique durable, l'idée a été abandonnée en 1936 après seulement un an de tests et d'études préliminaires.
Dans les années 1960, la France a pris une longueur d'avance avec la réalisation concrète de la toute première centrale marémotrice au monde, celle de la Rance en Bretagne, inaugurée en 1966. Avec ses 24 turbines Kaplan placées dans un barrage de 750 mètres de longueur, elle produit jusqu'à 240 MW. Cette centrale fonctionne toujours aujourd'hui et reste un exemple emblématique et concret du potentiel réel de l’énergie des marées.
Évolution technologique récente
Ces dernières années, on a vu débarquer des avancées vraiment intéressantes dans le secteur de l'énergie marémotrice. Par exemple, côté hydroliennes, les technologies de pales en matériaux composites hyper résistants comme la fibre de carbone ont permis d'améliorer nettement la durabilité face aux courants marins intenses. Autre progression notable : les nouveaux systèmes d'ancrage flottants, comme ceux de la plateforme du projet FloTEC d'Orkney en Écosse, permettent désormais l'installation des turbines à moindre coût, et surtout sans gros travaux invasifs pour l'environnement marin.
On note aussi un vrai bond en avant dans les capteurs et systèmes intelligents dédiés à la surveillance et à l'entretien. Aujourd'hui, grâce aux objets connectés (IoT), on suit en direct à distance les performances et l'usure des équipements sous-marins, réduisant directement les coûts de maintenance.
L'une des innovations les plus prometteuses reste le développement de turbines capables de capter les courants dans les deux sens de marée, comme c'est le cas de la turbine AR1500 testée dans le cadre du projet MeyGen. Cette technologie exploite mieux l'énergie disponible en comparant avec les systèmes plus anciens, qui, eux, ne récupéraient l'énergie que dans une direction à la fois.
Enfin, à souligner aussi la progression significative des outils de modélisation numérique des marées et courants marins. Des logiciels comme Telemac-3D permettent aujourd'hui de choisir avec beaucoup plus de justesse où implanter les turbines et anticipent même leurs impacts sur les courants et les écosystèmes locaux avant d'entamer quoi que ce soit. Pratique, concret et responsable.


500 TWh
La production potentielle annuelle d'énergie marémotrice dans le monde
Dates clés
-
1966
Mise en service de la Centrale marémotrice de la Rance en France, première centrale marémotrice de grande ampleur au monde.
-
1984
Inauguration de la centrale marémotrice d'Annapolis Royal au Canada, première installation en Amérique du Nord.
-
2003
Installation et tests préliminaires réussis des premières hydroliennes dans le détroit de Bristol au Royaume-Uni.
-
2008
Début du projet SeaGen en Irlande du Nord, première hydrolienne commerciale à grande échelle connectée au réseau.
-
2011
Lancement du projet MeyGen en Écosse pour la mise en place du plus grand parc hydrolien au monde.
-
2016
Début annuel officiel d'exploitation commerciale des hydroliennes du projet MeyGen.
Avantages de l'utilisation de l'énergie marémotrice
Source énergétique fiable et prévisible
L'énergie marémotrice a un sacré avantage côté prévisibilité : les mouvements des marées suivent précisément les cycles lunaires et solaires, donc franchement, il n'y a jamais de grosse surprise. On sait exactement, au jour et même à l'heure près, combien d'énergie on pourra récolter, parfois même des années à l'avance. Comparée au solaire ou à l'éolien, qui peuvent parfois jouer à cache-cache selon la météo, cette régularité est un vrai luxe pour gérer les réseaux électriques.
Par exemple, la centrale marémotrice de la Rance en France génère pratiquement 500 GWh d’électricité chaque année depuis les années 1960 sans fléchir, et son rendement fluctue très peu d'une année à l'autre. Cette fiabilité permet aux producteurs comme EDF d'anticiper précisément l'équilibrage du réseau, diminuant le besoin de stockages coûteux ou de centrales d'appoint. Même chose avec le projet d'hydroliennes MeyGen en Écosse, qui produit déjà de l'électricité avec une constance étonnante grâce à l'intensité stable des courants dans le Pentland Firth.
En gros, le côté prédictif et stable de la ressource marémotrice rassure clairement les opérateurs électriques et facilite la planification énergétique à long terme. C'est un peu comme avoir sous la main un agenda naturel ultra-précis pour gérer sa production électrique, et ça, franchement, c'est plutôt génial.
Faible empreinte carbone et émissions réduites
L'énergie marémotrice a un vrai avantage question climat : elle produit très peu de CO2. Une étude britannique menée autour du projet MeyGen a même montré qu'une hydrolienne produit environ 15 à 25 grammes de CO2 par kilowattheure durant toute sa vie, largement moins qu’une centrale à gaz — qui grimpe autour des 350 à 500 grammes.
Ce bilan carbone avantageux tient surtout à deux points : primo, les équipements sont souvent conçus pour durer entre 25 et 100 ans selon la techno choisie. La centrale marémotrice de la Rance est là depuis 1966, c’est pas rien ! Secundo, contrairement aux énergies fossiles, pas besoin de brûler quoi que ce soit, pas de combustion, donc une réduction nette des émissions directes.
En plus, les matériaux utilisés sont souvent recyclables ou réutilisables en fin de vie : acier, aluminium, voire béton marin éco-conçu. Certains constructeurs travaillent d’ailleurs activement à optimiser la fabrication en intégrant des procédés moins gourmands en énergie.
Ce bilan plutôt clean en fait une super alliée pour atteindre les objectifs climatiques : d’après l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), exploiter 1 GW d’énergie marémotrice pourrait éviter chaque année l’émission de près d’un million de tonnes de CO2 comparé au gaz naturel. Bref, une vraie carte à jouer dans la stratégie climat !
Potentiel énergétique élevé
La force des marées, c'est du sérieux niveau puissance. À elle seule, l'Europe a un potentiel techniquement exploitable estimé entre 30 et 50 gigawatts (GW), et à l'échelle mondiale, on parle carrément de l'ordre de 1 200 TWh par an, soit environ 5% de la production d'électricité globale. Certains spots sont spécialement intéressants, comme la baie de Fundy au Canada où la différence de niveau d'eau entre marée basse et marée haute dépasse souvent les 16 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages ! Rien qu'avec sa centrale historique, La Rance en Bretagne couvre déjà la consommation électrique annuelle de près de 225 000 habitants. Et pourtant, elle exploite qu'une petite partie de la force disponible dans la région. Les courants de marée offrent aussi un sacré potentiel : en Écosse aux îles Orcades, là où MeyGen développe son projet pilote, les courants marins atteignent régulièrement plus de 11 km/h, ce qui est particulièrement rapide et donc idéal pour la production d'électricité. Bref, côté puissance, les marées sont comme le vent, mais en carrément plus prévisible.
Synergies possibles avec d'autres énergies renouvelables
Associer l'énergie marémotrice à d'autres renouvelables intelligemment, c'est comme composer une équipe où chaque joueur renforce l'autre. Prenons l'exemple des marées et de l'éolien offshore : certaines plateformes au large des côtes utilisent déjà les mêmes infrastructures pour hydroliennes et éoliennes en mer. En Écosse, plusieurs projets pilotes combinent justement ces deux technologies sur un même site. Ça permet d'optimiser la production globale en équilibrant leurs pics respectifs : la marée prévisible compense parfaitement la variabilité du vent.
Côté solaire, ça paraît plus inattendu, non ? Pourtant, des chercheurs explorent l'installation de panneaux solaires flottants à proximité de barrages marémoteurs, comme dans certains projets en Corée du Sud. Ça limite l'impact sur le paysage côtier et permet d'alimenter en continu les réseaux locaux, jour et nuit, été comme hiver.
Autre idée sympa : exploiter l'excédent d'énergie marémotrice pendant les périodes creuses pour alimenter des unités de production d'hydrogène renouvelable. Ça se fait déjà, notamment à petite échelle sur des îles écossaises (Orkney Islands Project). En gros, l'hydrogène produit sert au stockage d'énergie pour fournir du courant ou alimenter transports et industries locales à d'autres moments. Une façon élégante de rendre l'énergie marémotrice plus souple dans sa gestion.
Bref, combiner intelligemment ces renouvelables rend les systèmes énergétiques plus stables, plus réguliers, tout en réduisant les coûts et leur impact sur l'environnement.
Le saviez-vous ?
Le potentiel mondial théorique de production électrique à partir des marées est estimé à environ 1 200 térawattheures (TWh) par an, soit plus que la consommation annuelle actuelle en électricité du Japon !
Les courants de marée fournissent une énergie prévisible et constante, contrairement à certaines autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, qui dépendent des conditions météorologiques.
La centrale marémotrice de la Rance en France, inaugurée en 1966, reste aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mise en service, l'une des plus grandes installations marémotrices opérationnelles au monde avec une puissance installée de 240 MW.
Les hydroliennes modernes, proches cousines sous-marines des éoliennes, peuvent produire autant d'énergie en utilisant un rotor de taille réduite, car l'eau possède une densité près de 800 fois supérieure à celle de l'air.
Défis et contraintes liés à l'énergie marémotrice
Impacts environnementaux potentiels
Effets sur les écosystèmes marins locaux
Les installations marémotrices ont parfois des effets directs sur la biodiversité marine à proximité. À cause de la modification des courants et des échanges d'eau, certaines espèces locales peuvent se retrouver perturbées dans leurs cycles migratoires ou leurs habitudes alimentaires. Un exemple concret, c'est la centrale de la Rance : après sa construction, on a constaté une baisse notable des populations de poissons migrateurs comme les saumons ou les aloses qui avaient du mal à franchir le barrage pour remonter les cours d'eau. Autre cas parlant, côté hydroliennes du projet MeyGen en Écosse : des études menées récemment montrent que les mammifères marins, comme les phoques ou certains dauphins, peuvent changer temporairement leur trajectoire pour contourner les machines lorsqu'elles tournent, sans qu'on ait observé jusqu'à présent de conséquence dramatique.
De façon plus subtile, la modification du brassage naturel peut également influencer l'accumulation des nutriments et le développement de micro-algues, entraînant parfois des modifications des chaînes alimentaires locales. Une astuce concrète pour limiter ces impacts : avant même l'installation, faire des évaluations poussées sur les schémas de circulation d'eau et la vie marine locale, histoire d'identifier les zones les plus sensibles à préserver coûte que coûte. Bien positionnées, conçues avec des passages artificiels pour les poissons migrateurs ou arrêtées temporairement pendant certains pics migratoires, ces infrastructures peuvent minimiser significativement leur impact sur les écosystèmes locaux.
Conséquences sur les courants et les sédiments
Les installations marémotrices comme les barrages ou les lagunes artificielles peuvent modifier les courants naturels et perturber le transport naturel des sédiments. Par exemple, à la centrale marémotrice de la Rance en Bretagne, on a observé un changement concret dans l'accumulation des sédiments en aval du barrage, avec apparition de dépôts importants sur les rives, nécessitant des dragages réguliers : environ 50 000 à 60 000 m³ de matériaux par an doivent être retirés dans certaines zones pour éviter une obstruction progressive. Ce phénomène affecte directement les espèces marines sensibles aux variations des fonds sableux et vaseux, comme les poissons plats ou certains crustacés locaux, dont les habitats naturels s'en trouvent perturbés. Pour minimiser ce genre d'impact, on réfléchit aujourd'hui à des solutions comme des ouvertures périodiques contrôlées des vannes ou encore à des systèmes modulaires moins invasifs comme des ensembles d'hydroliennes isolées sans barrières physiques, préservant davantage les courants et limitant cette perturbation du transport de sédiments.
Barrières technologiques et difficultés de mise en œuvre
Un obstacle majeur actuel concerne la résistance mécanique des équipements face aux conditions marines extrêmes. En mer, les marées et courants imposent des contraintes énormes, et assurer la durabilité des matériaux, notamment contre l'usure par corrosion et fatigue mécanique, reste un vrai défi. Par exemple, à la centrale pilote SeaGen en Irlande du Nord (opérationnelle de 2008 à 2019), les ingénieurs ont dû gérer constamment la maintenance à cause de la corrosion et de l’impact d'objets flottants sur les pales.
La gestion des bio-salissures est aussi une difficulté concrète. Les organismes marins, comme les algues et coquillages, se fixent très rapidement sur les hydroliennes. Cette colonisation biologique alourdit les machines, réduit leur rendement en freinant leur rotation et oblige à des nettoyages coûteux réguliers.
Autre complication pratique : l’installation logistique en mer. Pour poser des engins sous-marins, on mobilise souvent des navires spécialisés très coûteux, comme les "jack-up barges". Chaque jour d'immobilisation due aux intempéries représente potentiellement une perte importante en temps et en argent. Prenons le projet MeyGen en Écosse : l’installation de turbines a pris beaucoup plus longtemps que prévu initialement, entraînant des dépassements budgétaires significatifs.
Enfin, la connexion électrique entre les installations marémotrices et le réseau terrestre reste complexe. Il faut poser des câbles sous-marins fiables capables de résister longtemps sous l'eau salée tout en minimisant leurs pertes énergétiques sur des kilomètres. À titre d'exemple, la centrale de la baie de Fundy au Canada a rencontré des difficultés techniques sérieuses dans la mise en place de ses câbles sous-marins haute tension, ce qui a retardé considérablement son lancement opérationnel.
Coûts économiques et rentabilité
Produire de l'énergie avec les marées, c'est sûr, ce n'est pas donné. Pour éclairer un peu la lanterne : aujourd'hui, une centrale marémotrice affiche généralement un coût d'installation initial très élevé, tournant en moyenne autour de 3 à 5 millions d'euros par mégawatt installé, bien plus cher que l'éolien terrestre par exemple. Un site marémoteur doit gérer un environnement marin compliqué—la corrosion, les courants puissants, l'accès difficile pour maintenance—c'est une facture salée.
Autre aspect essentiel, c'est le fameux coût actualisé de l'énergie (le LCOE pour les intimes). Actuellement, le LCOE moyen pour l'énergie marémotrice tourne autour de 100 à 200 € par mégawattheure (MWh), selon diverses études et projets récents. Pour comparaison rapide, l'éolien offshore est déjà passé sous les 70 €/MWh en Europe ces derniers temps. Résultat, l'énergie marémotrice a encore besoin de subventions publiques sérieuses pour être compétitive.
Il y a quand même une bonne nouvelle : la rentabilité à long terme est vite intéressante lorsque l'installation tourne à pleine capacité sur plusieurs décennies. Des études britanniques récentes estiment par exemple qu'une réduction d'environ 30 à 40 % des coûts de fabrication des turbines marémotrices pourrait être atteinte à moyen terme grâce à la production à plus grande échelle et aux optimisations techniques en série.
Bref, l'énergie des marées coûte cher aujourd'hui, mais avec un peu de patience, d'investissements et de R&D, elle pourrait sérieusement jouer dans la cour des grands budgets énergétiques.
Acceptabilité sociale et conflits d'usage marin
La question de l'acceptabilité sociale autour des projets marémoteurs est épineuse : les communautés locales craignent parfois des répercussions concrètes sur leurs activités économiques et leur cadre de vie. Pour prendre un exemple précis, le projet marémoteur de Swansea Bay au Pays de Galles a buté pendant longtemps sur une opposition locale forte, principalement venant des pêcheurs et plaisanciers inquiets à juste titre d'une réduction de leur accès aux zones de pêche traditionnelles et de navigation.
Même chose au Canada, en Nouvelle-Écosse, où des tensions sont apparues dès les premières expérimentations d'hydroliennes. Les membres des Premières Nations et les communautés côtières ont soulevé très vite leurs inquiétudes sur l'impact que ces technologies auraient concrètement sur les populations de poissons et la biodiversité marine — des ressources dont ils dépendent au quotidien.
Ces exemples montrent un truc simple mais essentiel : pour éviter les embrouilles et conflits locaux, les porteurs de projet doivent absolument bosser main dans la main avec les communautés dès le début. Des études d’impact sérieuses, une vraie transparence et un dialogue régulier sont devenus incontournables pour concrétiser ce genre de projet. Aux îles Orcades, en Écosse, par exemple, les développeurs de projets marémoteurs jouent cartes sur table dès le départ, en impliquant les habitants dans des réunions régulières, avec écoute active de leurs retours et des adaptations concrètes aux projets. Résultat, là-bas, tout se déroule globalement plus calmement.
Autre point chaud : la gestion de l'espace marin, avec des conflits d'usage qui pointent souvent leur nez. Les zones marines sont souvent déjà exploitées (pêche commerciale, aquaculture, loisirs nautiques, protection environnementale…), impossible d’intégrer une centrale marémotrice sans tenir compte des usages existants. En France, par exemple, la baie du Mont-Saint-Michel, pourtant riche en potentiel énergétique, est aussi classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et très fréquentée. Résultat : projets marémoteurs très limités voire inexistants, histoire de ne pas se retrouver avec une levée de boucliers générale. C'est une situation classique de conflit d’usage marin qui nécessite des décisions hyper prudentes et raisonnées afin de trouver une solution concrète, acceptable et surtout durable pour tout le monde.
29 %
La part de l'électricité mondiale provenant de sources renouvelables en 2020
10 millions de tonnes
Les émissions de CO2 évitées annuellement par l'énergie marémotrice dans le monde
0,4 %
La part actuelle de la marémotrice dans le mix énergétique mondial
50 pays
Nombre de pays disposant d'un potentiel pour la production d'énergie marémotrice
359 GW
Le potentiel théorique d'énergie marémotrice dans le monde
| Aspects | Détails | Commentaires |
|---|---|---|
| Source d'énergie renouvelable | L'énergie marémotrice est générée par le mouvement des marées, causé par l'interaction gravitationnelle entre la Terre, la lune et le soleil. | Contrairement aux combustibles fossiles, l'énergie marémotrice est inépuisable tant que les forces gravitationnelles agissent. |
| Prévisibilité | Les marées sont hautement prévisibles, permettant de planifier avec précision la production d'énergie. | Cette caractéristique facilite l'intégration de l'énergie marémotrice dans le réseau électrique et la gestion de la demande. |
| Impact environnemental | Les installations marémotrices ont un faible impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. | Toutefois, des études approfondies sont nécessaires pour évaluer les impacts locaux sur les écosystèmes marins. |
Exemples et cas d'étude internationaux
La centrale marémotrice de la Rance (France)
Installée dans l'embouchure de l'estuaire de la Rance entre Saint-Malo et Dinard, cette centrale inaugurée en 1966 est toujours opérationnelle et détient longtemps le titre de la plus puissante centrale marémotrice au monde avec 240 MW installés répartis sur 24 turbines.
Fait intéressant : elle exploite une différence de marée moyenne d'environ 8 mètres, l'une des plus importantes en Europe. Chaque année, elle produit autour de 500 GWh, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle d'une ville d'environ 225 000 habitants, comme Rennes par exemple. Pas mal pour une installation vieille de plus de cinquante ans !
Techniquement parlant, les turbines tournent aussi bien à marée montante (flux) qu'à marée descendante (reflux). Dans la pratique, la centrale fonctionne donc de manière réversible, adaptant sa production au rythme régulier des marées. Point bonus écologique : cette flexibilité limite un peu les perturbations pour la faune aquatique locale, qui peut circuler selon des ouvertures régulières dans le barrage.
Côté impact environnemental justement, tout n'est pas rose non plus. Après le barrage, la sédimentation s'est accrue dans certaines zones, modifiant durablement les habitats naturels. Des scientifiques continuent d'observer ces évolutions pour comprendre, anticiper et réduire les impacts futurs.
Aujourd'hui, la Rance sert aussi de référence technique et scientifique pour d'autres projets marémoteurs plus récents dans le monde. Elle reste un exemple concret de succès industriel qui continue d'attirer chercheurs et ingénieurs internationaux curieux de comprendre comment faire fonctionner durablement l'énergie des marées.
Le projet MeyGen en Écosse
Situé dans le détroit du Pentland Firth, au nord de l'Écosse, MeyGen est le plus ambitieux projet mondial d'énergie marémotrice à base d'hydroliennes. Lancé par l'entreprise Atlantis Resources, il prévoit à terme une puissance installée de 398 mégawatts, suffisante pour alimenter environ 175 000 foyers écossais. Dès sa première phase opérationnelle en 2016, le projet a installé 4 hydroliennes géantes, chacune pesant près de 200 tonnes, ancrées solidement par des fondations sous-marines posées par des grues spécialisées. La zone sélectionnée bénéficie de courants marins extrêmement puissants, atteignant régulièrement jusqu'à 18 km/h (environ 10 nœuds), offrant des conditions optimales.
Ce site fait figure de pionnier grâce à sa contribution en données précieuses sur les performances réelles des hydroliennes en pleine mer. MeyGen collabore d'ailleurs étroitement avec des chercheurs britanniques et internationaux afin d'optimiser ses turbines et leurs pales, fabriquées en matériaux composites résistants à l'érosion et la corrosion. Malgré les progrès tangibles réalisés, MeyGen a connu quelques soucis techniques précoces, notamment liés à la maintenance sous-marine difficile et coûteuse en raison du climat maritime rude et imprévisible autour des Orcades.
En matière environnementale, plusieurs études sont en cours sur place, en lien avec des scientifiques et des universités locales. Objectif : mesurer précisément l'impact du projet sur la biodiversité marine locale, en particulier sur les populations de poissons, crustacés et mammifères marins. Pour le moment, les résultats préliminaires sont plutôt rassurants : ils indiquent que les grands mammifères marins ont tendance à éviter naturellement les zones occupées par les installations, réduisant ainsi nettement tout risque de collision.
Foire aux questions (FAQ)
Les principaux impacts incluent la modification locale des écosystèmes marins, potentiellement affectant la biodiversité, les courants et sédiments, ainsi que la migration de certaines espèces aquatiques. Ces impacts nécessitent des études approfondies et une planification minutieuse avant toute construction.
La production d'énergie marémotrice est périodique et prévisible, suivant les cycles réguliers et connus des marées. Contrairement au solaire ou à l'éolien, ses variations peuvent être anticipées avec précision sur plusieurs années à l'avance, facilitant ainsi son intégration sur les réseaux.
L'Agence internationale de l'énergie estime que le potentiel technique mondial exploitable de l'énergie marémotrice pourrait atteindre jusqu'à 1 200 térawattheures par an, ce qui équivaudrait environ à la consommation annuelle d'électricité combinée du Royaume-Uni et de l'Espagne.
Oui, l'énergie marémotrice est considérée comme renouvelable car elle exploite les mouvements naturels et réguliers des marées, générés par la gravité de la Lune et du Soleil, deux phénomènes naturels inépuisables sur l'échelle humaine.
Actuellement, l'énergie marémotrice coûte entre 150 et 400 euros par mégawattheure selon les technologies et les conditions spécifiques, ce qui reste relativement élevé par rapport aux coûts actuels de l'éolien et du solaire. Cependant, ces coûts pourraient diminuer avec l'échelle industrielle croissante et les avancées technologiques.
Parmi les pays pionniers, on retrouve la France avec la centrale historique de la Rance, le Royaume-Uni, notamment l'Écosse avec le projet MeyGen, la Corée du Sud avec la centrale du lac Sihwa, et le Canada, notamment la baie de Fundy, connue pour ses marées considérables.
Les freins principaux à son développement massif sont les coûts initiaux élevés, les contraintes environnementales et techniques complexes, ainsi que les potentiels conflits d’usage de l’espace marin avec d’autres activités économiques ou récréatives.
Tout à fait. L'énergie marémotrice peut être utilisée en combinaison avec des solutions comme l'énergie éolienne offshore, offrant une production énergétique diversifiée et plus stable sur une même zone géographique, aidant ainsi à complexifier moins les systèmes énergétiques et leurs infrastructures associées.
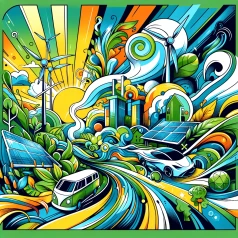
Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)
Quizz
Question 1/3
