Introduction
Contexte global et environnemental
Le transport en voiture individuelle est aujourd’hui responsable d’environ 12 % du total des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Rien qu'en France, un trajet quotidien moyen domicile-travail en voiture tourne autour de 26 km aller-retour, générant environ 2 tonnes de CO₂ annuelles par conducteur. À ce rythme, l'objectif européen d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 risque clairement de coincer.
En parallèle, le secteur du vélo à assistance électrique (VAE) connait une croissance folle : en France, plus de 738 000 unités ont été vendues rien qu’en 2022, soit presque un quart du marché total des vélos. Un engouement sympa sur le papier, sauf que la fabrication des batteries lithium-ion utilisées par ces vélos pose clairement des questions côté environnemental, en particulier pour l'extraction des matériaux critiques comme le lithium et le cobalt.
Cerise sur le gâteau, d'ici 2030, l’Agence Internationale de l’Énergie estime que la demande en lithium pour les batteries pourrait être multipliée par plus de 10 par rapport à 2020. Autant dire que réfléchir sérieusement à l'empreinte carbone réelle des moyens de transport alternatifs n'est plus franchement une option, mais une nécessité.
8 milliards de tonnes
Les émissions mondiales de CO2 dues au secteur des transports en 2018.
Variable kg par km
Les émissions moyennes de CO2 par kilomètre pour une voiture électrique varient selon la source de production électrique.
0.06 kg
Les émissions moyennes de CO2 par kilomètre pour un vélo à assistance électrique.
30%
La part des émissions de CO2 provenant du secteur des transports dans le total des émissions mondiales.
Importance du choix des modes de transport
Un trajet quotidien standard de 10 km aller-retour en voiture thermique émet facilement autour de 2 tonnes de CO₂ chaque année. La même distance avec un vélo à assistance électrique ? Dix fois moins d'émissions. Choisir son mode de transport quotidien a donc un effet immédiat et concret sur son empreinte carbone annuelle. L'ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) rappelle que remplacer une voiture par un vélo pour des trajets courts diminue significativement les émissions notamment sur la pollution aux particules fines et aux oxydes d'azote (NOx). Ces substances sont directement responsables de problèmes respiratoires en ville (asthme et bronchites chroniques). On sait d’ailleurs que dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, une voiture individuelle passe en moyenne 80 % de son temps immobile dans les bouchons ou à chercher une place. Le choix d'utiliser plus souvent un vélo électrique permet non seulement de réduire directement les rejets polluants, mais aussi de fluidifier le trafic urbain. Dans une métropole comme Copenhague, où plus de 60 % des citoyens pédalent quotidiennement, l'air est significativement plus sain, avec une pollution atmosphérique parmi les plus basses d'Europe. Enfin, au-delà de la réduction directe des émissions polluantes, ce choix joue aussi sur l’ensemble du cycle de vie : moins de voitures signifie moins de nouvelles routes et moins de béton, autant d'économies indirectes de CO₂ réalisées.
Objectif de l'étude
Le but ici, c'est de comparer clairement deux options hyper répandues pour savoir où on en est vraiment sur le plan environnemental. On sait tous à peu près que les vélos à assistance électrique polluent moins que les voitures classiques, c'est cool, mais concrètement, ça donne quoi niveau chiffres ? Quels sont réellement les écarts d'émissions de CO₂ quand on prend en compte toute la chaîne : fabrication, utilisation, entretien, recyclage des composants, tout compris quoi. Ce qu'on veut faire concrètement, c'est identifier les aspects précis qui pèsent vraiment lourd dans l'empreinte carbone de chacun de ces deux modes de transport. L'objectif final, c'est de filer des infos objectives et ultra-concrètes aux citoyens et décideurs pour qu'ils puissent mieux comprendre l'impact réel de leurs choix au quotidien. Pas de débat théorique ici : des faits, des chiffres, des résultats explicites pour vraiment savoir si le vélo électrique vaut largement le coup pour le climat ou pas franchement.
Méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone
Définition de l'empreinte carbone
L'empreinte carbone, c’est le total des gaz à effet de serre produits directement ou indirectement par une activité humaine, un produit ou une entreprise. On exprime ça généralement en kilos ou tonnes équivalent CO₂ (eq CO₂), histoire de prendre en compte la contribution des différents gaz comme le méthane ou le protoxyde d'azote, dont les pouvoirs réchauffants varient clairement. En gros, ton trajet quotidien, ton vélo électrique ou même le steak dans ton assiette ont une empreinte carbone bien précise, souvent calculée en faisant une analyse Cycle de Vie (ACV), qui inclut tout : extraction des matières premières, fabrication, transport, utilisation et fin de vie du produit. Au-delà des classiques émissions directes liées à la combustion, on oublie parfois les émissions indirectes, comme celles générées lors de l’extraction minière des métaux nécessaires aux batteries lithium-ion ou durant la construction des infrastructures routières. Une bonne évaluation d’empreinte carbone va donc prendre en compte l'ensemble des étapes et des détails — c'est ce qu'on appelle la prise en compte du "scope" d'évaluation (scope 1, 2 et 3, pour être précis).
Choix des critères et des indicateurs
Pour comparer sérieusement l'empreinte carbone des vélos électriques et des voitures, il faut sélectionner quelques critères vraiment concrets. D'abord, impossible de zapper la fabrication et l'assemblage : tout ce qui se passe depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'atelier de montage (acier, aluminium, lithium des batteries, plastiques, tout compte). Ensuite, on regarde la consommation directe du véhicule, en prenant en compte les kilomètres parcourus par rapport à l'énergie nécessaire. Pour les vélos électriques, c'est surtout la consommation d'électricité par kilomètre qui importe. Pour les voitures traditionnelles, l'essentiel tourne autour du type de carburant et sa consommation réelle.
Le cycle de vie complet entre évidemment en jeu : les coûts énergétiques pour produire, remplacer ou entretenir chaque composant clé (pneus, chaînes, freins, batteries des vélos électriques). Autre facteur incontournable : les émissions indirectes liées aux infrastructures nécessaires, comme les stations-service, les bornes de recharge électrique, les ateliers d'entretien et les routes (oui, même refaire régulièrement le revêtement routier génère beaucoup de CO₂).
Enfin, la méthode d'analyse doit absolument intégrer une référence claire au mix énergétique régional. Parce que, selon qu'on recharge ses batteries avec de l'électricité produite par du charbon polonais ou par de l'hydroélectricité norvégienne, la balance carbone change clairement de visage. Ces critères précis assurent une évaluation juste et fiable — pas juste un vague ressenti d'écolo ou de conducteur du dimanche.
Sources des données utilisées
Pour ce comparatif, les données viennent principalement de bases solides comme celles de l'ADEME (Agence de la Transition Écologique) et d'organismes internationaux reconnus type Agence Internationale de l'Énergie (AIE). Elles prennent en compte le détail des composants des vélos électriques (cadre, batterie, moteur), mais aussi les différentes étapes de production des voitures classiques depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'assemblage final en usine.
Les chiffres sur la consommation réelle des véhicules sont tirés directement des mesures effectuées par des laboratoires indépendants, comme celles de l'organisme allemand Fraunhofer Institute spécialisé dans l'évaluation technique et écologique. De même, des études terrain récentes sont utilisées pour refléter précisément les modes d'utilisation réels des vélos électriques (nombre moyen de kilomètres parcourus, habitudes de recharge), notamment via des enquêtes effectuées dans plusieurs grandes villes françaises (Paris, Bordeaux, Grenoble) en 2021 et 2022.
Les analyses du cycle de vie se basent aussi sur des données techniques fournies directement par des industriels européens et asiatiques fabricants de batteries lithium-ion. Pour l'impact des réseaux électriques, pas question de moyenne au hasard : les chiffres précis fournis par les bilans énergétiques régionaux publiés en 2022 par RTE (Réseau de Transport d'Électricité) et par différentes agences nationales européennes comme l'Umweltbundesamt (en Allemagne) sont intégrés aux calculs. Toutes ces sources sont récentes, traçables et disponibles publiquement.
| Critères | Vélos à assistance électrique | Voitures traditionnelles |
|---|---|---|
| Émissions CO2 par km | Environ 5-15 g CO2/km | Environ 150-250 g CO2/km |
| Production et fabrication | Environ 5-10% de l'empreinte carbone d'une voiture | Significative, inclut l'extraction des matières premières |
| Énergie nécessaire | Électricité, potentiellement renouvelable | Carburants fossiles, non renouvelables |
| Recyclage en fin de vie | Plus simple, moins de matières à traiter | Complexe, nécessite une gestion des déchets plus importante |
Les émissions de CO₂ des vélos à assistance électrique
Données chiffrées sur les émissions des vélos à assistance électrique
Fabrication et assemblage des composants
La fabrication des vélos à assistance électrique (VAE) génère une grosse partie de leur empreinte carbone totale bien avant que tu ne roules avec. Par exemple, le cadre en aluminium d'un VAE pèse lourd dans l'équation (jusqu'à 170 kg de CO₂ rien que pour produire un cadre selon certaines études). L'origine géographique de la production joue aussi beaucoup : un vélo assemblé localement en France, avec des composants européens, ça diminue considérablement les émissions dues au transport maritime depuis l'Asie, qui représentent jusqu'à 10 % de l'empreinte d'un vélo importé.
Choisir des composants issus de matériaux recyclés ou certifiés responsables (comme un cadre en aluminium recyclé ou des pneus faits en caoutchouc naturel certifié FSC) réduit aussi fortement l'empreinte globale. Un coup facile à jouer pour les fabricants : optimiser leur chaîne d'approvisionnement pour privilégier l'approvisionnement court et des matériaux durables peut permettre de réduire de 20 à 30 % l'impact écologique lié à la production d'un VAE.
Production de la batterie
La production des batteries lithium-ion pour vélos électriques, c'est clairement une étape clé niveau empreinte carbone. Elle représente souvent jusqu’à 40 à 50 % des émissions totales du cycle de vie d'un vélo électrique. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer ces batteries, on utilise énormément de matériaux spécifiques comme le lithium, le cobalt ou le nickel. Concrètement, extraire du lithium dans des régions comme le désert d'Atacama au Chili, ça consomme beaucoup d'eau et d’énergie : produire une tonne de lithium requiert environ 1,9 million de litres d'eau. Pour le cobalt, majoritairement issu de République Démocratique du Congo, son extraction pose des questions éthiques importantes en plus de l’impact écologique.
Ensuite, la fabrication elle-même demande une grosse quantité d’énergie, surtout en Chine ou en Corée du Sud, pays où l'électricité provient majoritairement de centrales à charbon ou au gaz naturel, d'où des émissions de CO₂ assez lourdes : typiquement, produire une batterie de vélo électrique moyenne (~400 Wh) génère de 40 à 70 kg de CO₂ selon l'usine et l'origine d'énergie utilisée.
Si tu cherches à limiter ton impact à l'achat d'un vélo électrique, vérifie tout simplement où est fabriquée la batterie — celles produites dans des pays où l'électricité provient de sources renouvelables auront une empreinte plus faible. Autre piste concrète, privilégier des fabricants qui utilisent des ressources recyclées dans leur production — certaines marques commencent à intégrer jusqu’à 10 à 20 % de matériaux recyclés dès l'étape de fabrication, ce qui réduit nettement leur empreinte.
Consommation électrique durant l'utilisation
Un vélo électrique moyen consomme autour de 0,5 à 1 kWh aux 100 km selon le mode d'assistance choisi et le terrain fréquenté. Pour te donner une idée concrète : si tu recharges ta batterie typique de 400 Wh, tu dépenses à peu près 0,08 euros par charge avec le prix moyen français d'électricité actuel (environ 0,20 €/kWh). Ça veut dire que pour 1000 km parcourus, t'as déboursé moins d'1 euro au total. Côté émissions de carbone, avec le mix électrique français plutôt bas-carbone (environ 56 gCO₂/kWh en moyenne), le vélo électrique consomme environ 0,028 à 0,056 kg de CO₂ tous les 100 km. Pas énorme comparé aux véhicules essence ou diesel, qui dépassent souvent les 10 kg de CO₂ pour la même distance. Pour optimiser davantage, évite les chargements quotidiens complets inutiles, tu prolongeras ainsi la durée de vie de ta batterie tout en réduisant l'impact écologique global du vélo.
Impact du cycle de vie des batteries : recyclage et impacts environnementaux
Quand on parle batterie de vélo à assistance électrique (VAE), c'est souvent au lithium-ion qu'on a affaire. Ok, c'est la technologie du moment, mais on oublie souvent qu'une batterie lithium-ion contient des métaux rares comme le lithium, le cobalt ou le nickel. Et clairement, l'extraction de ces matériaux, c'est pas une promenade de santé pour la planète : mines à ciel ouvert, pollution des sols, consommation d'eau assez ahurissante (13 tonnes d'eau pour obtenir une tonne de lithium au Chili, par exemple).
Le vrai enjeu arrive surtout quand la batterie rend l'âme après environ 500 à 1 000 cycles de charge, soit souvent entre 5 et 7 ans d'utilisation. Là, on se pose la question du recyclage. Aujourd'hui, en Europe, on est autour de seulement 50% de recyclage réel sur ces batteries au lithium, parce que techniquement, trier et récupérer ces ressources, c'est compliqué, énergivore et ça coûte cher. Pourtant des boîtes commencent à bien se bouger sur le sujet, comme SNAM en France ou Umicore en Belgique, qui arrivent à récupérer jusqu'à 70-80% de certains matériaux précieux à partir des batteries VAE usagées.
On peut quand même nuancer un poil tout ça : même si tout n'est pas idéal, l'empreinte carbone totale d'une batterie lithium-ion (fabrication, utilisation, recyclage compris) reste largement inférieure à celle créée par le carburant brûlé par une voiture, même très économe. En chiffres rapides, le cycle complet d'une batterie lithium-ion pour VAE tourne autour de 60 à 70 kg CO₂ sur toute sa vie, contre plusieurs tonnes de CO₂ pour une voiture thermique traditionnelle moyenne.
Après, reste le sujet un peu moins connu mais aussi impactant : la seconde vie. Certaines boîtes expérimentent de réutiliser les batteries trop faibles pour le VAE afin d'alimenter, à petite échelle, maisons ou éclairages publics. Une manière intelligente et clairement plus écologique de tirer jusqu'au bout tous ces métaux rares qu'on est allé chercher sous terre.


50 %
La réduction des émissions de CO2 possible en passant de la voiture à l'utilisation régulière du vélo.
Dates clés
-
1885
Invention du premier vélo à assistance électrique par Thomas Davenport
-
1967
Première mise en circulation de la voiture électrique 'Comuta'
-
2000
Début de la popularisation des vélos à assistance électrique en Europe
-
2008
Lancement du programme 'Vélib' à Paris, favorisant l'usage du vélo en ville
-
2010
Introduction des premières voitures électriques grand public sur le marché
-
2015
Accord de Paris sur le climat pour limiter le réchauffement climatique
-
2018
Essor des vélos à assistance électrique en Chine
Les émissions de CO₂ des voitures traditionnelles
Émissions liées à la fabrication et à l'assemblage
Produire une voiture classique, c'est environ 6 tonnes de CO₂ en moyenne. Ça grimpe bien au-delà pour certains SUV, parfois jusqu'à 10 tonnes. Pourquoi autant ? Parce que l'extraction des métaux, notamment l'acier et l'aluminium, pèse lourd : environ 50% des émissions du total fabrication-assemblage. Rien que pour façonner la carrosserie, on chauffe des fours industriels à énorme consommation d'énergie fossile, souvent du gaz ou du charbon. Produire une batterie de voiture électrique est connu pour être gourmand, mais même fabriquer la voiture classique sans batterie coûte cher en carbone, à cause de procédés industriels très chauds, chauffés au fossile.
Autre truc pas très connu : l'électronique embarquée dans ta voiture moderne contient des puces électroniques et composants dont la fabrication requiert des procédés chimiques complexes, très consommateurs d'énergie et d'eau. Ça ne représente pas l'essentiel des émissions (quelques pourcents seulement), mais ça grimpe vite avec les véhicules toujours plus connectés.
Assembler une voiture n'est pas juste énergivore en usine : il faut aussi penser à toutes les pièces importées d'un bout à l'autre du monde, avec des transports internationaux par bateau, avion ou camion qui s'ajoutent au compteur carbone, représentant parfois jusqu’à 10 % de la facture CO₂ totale du véhicule.
Données sur la consommation de carburant et émissions directes
Essence
Un moteur essence classique balance autour de 2,3 kg de CO₂ par litre de carburant consommé. Si ta voiture affiche une conso moyenne de 7 litres aux 100 km, t'expédies direct près de 16 kg de CO₂ dans l'atmosphère juste pour un aller Paris-Orléans (environ une centaine de km). Certaines options aident quand même à limiter les dégâts : une conduite plus fluide, sans trop d'accélérations brutales, peut réduire ta conso de carburant de jusqu'à 15 %. Le choix du carburant joue aussi : par exemple, les carburants de type SP95-E10, composés de 10 % de biocarburants (éthanol d'origine végétale), diminuent légèrement l'empreinte carbone par litre brûlé, avec jusqu'à 6 à 7 % d'émissions en moins par rapport à l'essence pure sans éthanol. Si tu veux vraiment agir rapidement, vérifie régulièrement la pression des pneus : une pression trop faible augmente ta conso de carburant de près de 4 %.
Diesel
Une voiture diesel émet généralement autour de 120 à 180 grammes de CO₂ par kilomètre, selon le modèle et la manière dont tu conduis. Mais au-delà du CO₂, le truc vraiment problématique des diesels, ce sont les fameux oxydes d'azote (NOx). Concrètement, ces NOx flinguent la qualité de l'air urbain et entraînent des problèmes respiratoires pas très cool pour la santé. Même si les normes Euro 6 visent à limiter ces émissions, des tests réalisés dans la vraie vie (comme ceux réalisés par ICCT suite au Dieselgate en 2015) montrent que sur route, certaines bagnoles diesel récentes dépassent parfois de plusieurs fois les niveaux autorisés en conditions réelles comparé aux labos d'homologation. Donc OK, niveau conso, ton diesel peut être plus sobre qu'une essence, mais si tu fais majoritairement des trajets courts en ville, le diesel est en fait une fausse bonne idée : moteur plus froid, donc combustion moins optimale avec encore plus d'émissions polluantes à la clé. Pour vraiment réduire tes émissions en diesel, tu peux adopter une conduite souple, éviter les accélérations brusques ou encore faire régulièrement entretenir ton véhicule (filtres, injecteurs, vanne EGR au top, etc.). Mais ne te fais pas trop d'illusions non plus : même à son top, un diesel restera clairement plus polluant en NOx que les autres motorisations.
Gaz naturel
Le gaz naturel, ça rejette moins de CO₂ que l'essence et le diesel, c’est clair (environ 20 à 25 % d’émissions en moins par km). Mais attention, tout n'est pas rose. Si on ajoute les fuites pendant l’extraction ou le transport (le fameux méthane, un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO₂ sur 100 ans), l'impact réel grimpe vite. Par exemple, aux USA, certaines études montrent un taux de fuite pouvant atteindre jusqu'à 2 à 4 % du gaz naturel extrait : ça limite sérieusement l'avantage environnemental. Autre truc utile à savoir : les véhicules roulant au gaz naturel comprimé (GNC) nécessitent des réservoirs renforcés et une infrastructure spécialisée plus coûteuse, dont l’impact carbone lié à la fabrication et à la maintenance n’est pas négligeable. Donc oui, rouler au gaz naturel, c'est moins pire que l’essence côté carbone direct, mais si on veut vraiment réduire l’impact carbone, ce n’est clairement pas la solution miracle.
Émissions indirectes et annexes (entretien, infrastructures, etc.)
Même si on pense d'abord aux carburants, faut pas oublier ce qui se passe autour d'une voiture. Par exemple, les infrastructures, c'est-à-dire les routes, parkings et autoroutes, ont une empreinte carbone claire : selon l'ADEME, la construction d'une route génère jusqu'à 700 tonnes de CO₂ par kilomètre. Et ça grimpe encore plus avec les autoroutes à plusieurs voies.
Côté entretien courant, c'est aussi loin d'être neutre. Rien que le remplacement des pneus, par exemple, génère indirectement une émission moyenne d'environ 87 kg de CO₂ pour chaque train de pneu produit (selon Michelin). Puis il y a les huiles moteur, les liquides de refroidissement ou les filtres. Produire et traiter tout ça n'est pas sans conséquence.
Même les stations-service impliquent un coût environnemental caché, dû à leur construction et à leur approvisionnement constant. Selon une estimation européenne, une station essence classique rejette indirectement autour de 300 tonnes de CO₂ sur son cycle de vie complet (matériaux de construction, équipements et consommation énergétique générale).
En gros, les voitures ne polluent pas uniquement en roulant : chaque élément annexe et indirect implique sa propre facture carbone, souvent sous-estimée.
Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ? L'empreinte carbone d'un vélo à assistance électrique est en moyenne 8 fois inférieure à celle d'une voiture compacte essence sur une distance de 1 km.
Le saviez-vous ? En France, les voitures individuelles représentent 15% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le transport routier représente 27% des émissions totales.
Le saviez-vous ? Un trajet de 5 km en voiture émet environ 1 kg de CO2, alors qu'en vélo à assistance électrique, les émissions correspondantes sont négligeables.
Comparaison directe des vélos à assistance électrique et des voitures traditionnelles
Émissions de CO₂ par kilomètre parcouru
Un vélo à assistance électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, émet en moyenne autour de 22 grammes de CO₂ par kilomètre. Une voiture classique essence récente, elle, tourne plutôt autour de 120 à 180 grammes par kilomètre. Rien que du concret. Si on prend les modèles diesel récents, c'est légèrement mieux : environ 100 à 160 grammes de CO₂ par kilomètre, mais on reste loin du vélo électrique. Évidemment, la manière dont ton électricité est produite joue un rôle important. Avec une électricité produite à partir de charbon (comme en Allemagne ou en Pologne), ton vélo à assistance électrique peut grimper près des 40 grammes par kilomètre. Par contre, grâce à des énergies renouvelables (solaire, éolien ou hydraulique), tu descends facilement sous les 10 grammes par kilomètre. Côté voiture, il y a aussi un effet "secondaire", car les embouteillages et petits trajets courts font grimper les émissions réelles par kilomètre parcouru de plus de 20 %. Un vélo, lui, ne souffre quasiment pas de ce phénomène. Dernier détail qui compte : le poids. Une voiture pèse environ 1 200 kg, parfois beaucoup plus, transportant souvent juste une ou deux personnes. Un vélo électrique, c'est environ 25 kg en moyenne, batterie comprise. Ça explique clairement pourquoi le compteur carbone penche largement de son côté.
Analyse comparative sur l’ensemble du cycle de vie
Quand tu regardes l'ensemble du cycle de vie, fabriquer un vélo électrique, c'est entre 100 kg et 250 kg de CO₂ rejetés selon les modèles et les batteries utilisées. Une voiture thermique, en revanche, démarre autour de 5 à 10 tonnes de CO₂ émises rien que pour la production (et encore, pour une petite citadine !). La différence est énorme dès le départ.
Ensuite, quand on passe à l'utilisation, l'écart devient vraiment dingue. Compte environ 6 grammes de CO₂ par kilomètre en moyenne avec un vélo électrique alimenté par une électricité européenne standard. Avec une voiture thermique, même en restant sur le modèle le plus clean possible, t'es facile au-dessus des 100 grammes de CO₂ par kilomètre. Et si tu prends une voiture plus puissante ou plus polluante, tu peux vite doubler ou tripler ce chiffre.
Autre point essentiel : la gestion de fin de vie, surtout côté vélos électriques. Les batteries lithium-ion du vélo nécessitent un bon recyclage ; mal recyclées, elles perdent tout avantage environnemental gagné précédemment. Mais en général, avec un recyclage correct, on récupère et revalorise une grande partie des composants. Côté voiture, le recyclage fonctionne assez bien actuellement, mais beaucoup de pièces finissent quand même en déchets non valorisés, pneus notamment, huiles et divers fluides.
Bref, si tu additionnes tout depuis la fabrication initiale jusqu'à la destruction ou au recyclage, un vélo électrique typiquement utilisé sur 15 000 km produit aux alentours de 300 kg à 450 kg de CO₂ (tout compris). Une voiture essence équivalente, elle, atteint souvent entre 3 et 4 tonnes de CO₂ minimum sur la même distance. Autrement dit, sur la totalité du cycle de vie, opter pour un vélo électrique reste clairement une solution très avantageuse si tu veux réduire ton impact carbone.
0.12 kg
Les émissions moyennes de CO2 par kilomètre pour une voiture essence.
0.12 kg
Les émissions moyennes de CO2 par kilomètre pour une voiture diesel.
4.2 millions
Le nombre de morts prématurées liées à la pollution de l'air chaque année dans le monde.
33 %
La part des émissions de CO2 dues au transport routier dans l'Union Européenne.
4.5 trillions
Le nombre annuel de kilomètres parcourus en voiture en Europe.
| Critères | Vélos à assistance électrique | Voitures traditionnelles |
|---|---|---|
| Émissions CO2 par km | Environ 22 g CO2/km | Environ 271 g CO2/km |
| Émissions CO2 sur 1 an (pour 10 000 km) | 220 kg CO2/an | 2710 kg CO2/an |
| Coûts énergétiques de fabrication | 50-70% moins élevés que ceux des voitures | Plus élevés, nécessitent plus de matériaux et d'énergie |
Facteurs influençant les résultats de l'évaluation
Filière de production énergétique régionale
Pas besoin d'être un expert pour comprendre que pédaler électrique émet peu, mais tout dépend du jus qu'on met dans la batterie. En France, une grosse partie de l'électricité (autour de 70 %) vient du nucléaire, qui balance très peu de CO₂, environ 6 grammes par kilowattheure (g/kWh) produit, contre plus de 500 g/kWh pour les centrales à charbon encore utilisées en Allemagne ou en Pologne. Donc, charger son vélo électrique à Paris ou à Lyon, ça reste super faible niveau émissions carbone. Mais en Allemagne, où tout l'électrique reste encore dépendant à presque 30 % des énergies fossiles (comme le lignite, un charbon très polluant), pédaler électrique c'est moins efficace côté climat. Concrètement, un vélo électrique chargé en France représente en moyenne entre 7 à 15 g de CO₂ par kilomètre, alors qu'en Allemagne ça monte facilement jusqu'à 20-25 g/km. Moralité, si on veut rouler vraiment vert à vélo électrique, jeter un œil à la carte énergétique de la région ou du pays, c’est pas du luxe !
Foire aux questions (FAQ)
Les vélos à assistance électrique ont une empreinte carbone beaucoup plus faible que les voitures traditionnelles en raison de leur faible consommation d'énergie et de leurs émissions réduites.
L'empreinte carbone des vélos à assistance électrique est généralement calculée en prenant en compte la production, l'utilisation et le recyclage des composants du vélo.
Oui, l'utilisation des vélos à assistance électrique contribue à réduire les émissions de CO2 en remplaçant les trajets en voiture par des trajets plus écologiques et moins polluants.
En plus de réduire les émissions de CO2, les vélos à assistance électrique contribuent à diminuer la pollution de l'air, à réduire la congestion routière et à promouvoir un mode de vie plus actif.
Oui, plusieurs études ont été menées pour comparer de manière approfondie l'empreinte carbone des deux modes de transport, mettant en lumière les avantages environnementaux des vélos à assistance électrique.
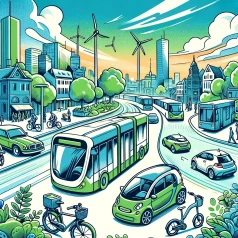
Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)
Quizz
Question 1/5
