Introduction
On entend souvent débattre sur ce que l'on mange : bio ou pas bio ? Pas toujours facile de s'y retrouver. Certains misent tout sur le bio, parce que c'est naturel, sans pesticides chimiques et respectueux des animaux. D'autres préfèrent le conventionnel, souvent plus productif et économique. Mais concrètement, quel impact ces deux approches agricoles ont-elles sur notre santé et notre environnement ? Ça vaut vraiment le coup de payer un peu plus cher pour manger bio ? Cet article explore tout ça : les principes des deux méthodes, leurs bénéfices ou risques pour notre santé, leur rôle côté biodiversité, gestion de l'eau, qualité des sols, et bien sûr ce que ça implique pour notre portefeuille et celui des agriculteurs. Bref, on fait le point, clairement et simplement, pour vous aider à y voir plus clair.40% des exploitations agricoles
Des exploitations agricoles biologiques ont moins de probabilité d'avoir des ressources en eau contaminées, par rapport aux exploitations conventionnelles.
25% de plus en moyenne
Les fruits et légumes biologiques contiennent plus d'antioxydants que les produits conventionnels.
3% des terres agricoles
Seulement 3% des terres agricoles dans le monde sont utilisées pour la culture biologique.
20 % de moins
L'agriculture biologique utilise en moyenne 20% de moins d'eau que l'agriculture conventionnelle.
Introduction à l'agriculture biologique et conventionnelle
Tu as sûrement remarqué que le rayon bio du supermarché prend de plus en plus de place. Normal, le monde cherche à mieux manger et réduire le stress environnemental. Mais derrière cette tendance, il y a deux façons très différentes de produire notre nourriture : l'agriculture biologique d'un côté et l'agriculture conventionnelle de l'autre.
Ce qui sépare ces deux méthodes, c'est en gros comment elles utilisent les ressources naturelles et quels types de produits chimiques elles autorisent. L'agriculture bio joue la carte du naturel : pas question d'employer des pesticides ou engrais chimiques de synthèse. Au lieu de ça, elle mise sur les rotations de culture, les techniques naturelles ou biologiques pour gérer les parasites et préserver la santé des sols. Côté élevage, elle impose un meilleur traitement des animaux.
À l'inverse, l'agriculture conventionnelle fait souvent appel à des produits chimiques pour booster le rendement, protéger efficacement les cultures contre les maladies et produire en grande quantité. Forcément, niveau santé et environnement, ça pose question. Pourtant, c'est encore aujourd'hui l'agriculture classique (conventionnelle) qui nourrit majoritairement la planète. Entre besoin de productivité et volonté de consommer plus propre, l'équilibre n'est pas simple à trouver.
L'agriculture bio
Principes fondamentaux de l'agriculture bio
Absence de pesticides chimiques et engrais artificiels
Dans une exploitation bio certifiée, pas question d'utiliser des pesticides chimiques de synthèse (comme le glyphosate ou le chlorpyrifos) ni des engrais artificiels à base azotée issus du pétrole. À la place, on mise sur des méthodes naturelles comme le compostage, les purins de plantes (ortie, consoude) ou encore l'introduction d'insectes auxiliaires, comme la coccinelle, qui régule efficacement les pucerons sans la moindre goutte de chimie. Résultat concret : des études ont montré que les pommes ou les tomates issues de l’agriculture biologique contiennent en moyenne quatre fois moins de résidus nocifs (selon une étude de l'UFC-Que Choisir en 2019), un vrai plus pour notre santé à long terme. Autre exemple actionnable, planter des fleurs mellifères (bourrache, trèfle incarnat, phacélie) aux abords des cultures pour attirer les pollinisateurs et renforcer naturellement la protection contre les ravageurs. Des gestes simples pour les agriculteurs dont les consommateurs profitent directement en réduisant leur exposition quotidienne aux pesticides chimiques.
Rotation et diversification des cultures
Changer régulièrement de culture sur un même terrain et diversifier ce qu'on plante, c'est une sorte de boost naturel pour la terre. Concrètement, au lieu de cultiver toujours la même chose (comme du maïs ou du blé chaque année), tu alternes avec des légumineuses (pois, lentilles, trèfle...) qui captent l'azote présent dans l'air et nourrissent naturellement le sol. Par exemple, passer du blé une année à des pois ou du trèfle l'année suivante enrichit ton sol et réduit le besoin d'engrais chimiques. En variant les cultures aussi, on perturbe les cycles de prolifération des insectes nuisibles ou des maladies propres à certaines plantes, du coup, moins besoin de produits phytosanitaires. Une étude menée en France par l'INRA montrait même qu'une rotation intégrant des légumineuses pouvait réduire jusqu'à 50% l'utilisation de fertilisants azotés. Bref, intégrer rotation culturale et diversité végétale c'est bon pour tes rendements, bon pour l'environnement, et au final bon pour ton portefeuille.
Élevage respectueux du bien-être animal
Un truc vraiment cool dans l’élevage bio, c’est qu’on met davantage l’accent sur l’espace vital des animaux. Par exemple, en bio, pour les poules pondeuses, c’est au maximum 6 poules par mètre carré à l’intérieur, contre parfois plus de 15 dans les élevages conventionnels. Et elles ont obligatoirement accès au plein air, où chaque poule dispose d’au moins 4 m² pour gambader dehors — c’est écrit noir sur blanc dans le règlement européen (règlement UE n°2018/848). Pour les porcs en agriculture bio, ce sont pareil des densités plus faibles et un accès direct vers l'extérieur quasiment au quotidien, avec aussi un sol naturel pour fouiller et s’occuper. Les bêtes doivent avoir des espaces adaptés pour leur permettre de se comporter naturellement : des perchoirs pour les poules, de la paille et un coin ombragé pour les vaches et les cochons. De plus, en bio, pas question d’utiliser des traitements hormonaux ou antibiotiques comme routine : seulement quand un animal est vraiment malade, et sous stricte surveillance. On privilégie le préventif, pour que la vie à l’élevage soit la plus saine possible.
Avantages de l'agriculture biologique pour la santé
Réduction de l'exposition aux résidus chimiques
Manger bio, c'est une méthode concrète pour limiter ta consommation quotidienne de substances chimiques controversées. Par exemple, une étude menée par Générations Futures en 2019 indique que les consommateurs réguliers de bio présentent en moyenne six fois moins de résidus de pesticides dans leurs urines que ceux consommant une alimentation conventionnelle. Parmi les fruits et légumes les plus traités figurent la pomme, le raisin, la fraise et les épinards. Passer au bio pour ces quelques aliments précis, en priorité, peut rapidement faire baisser ton exposition aux produits chimiques. Une démarche utile surtout pour les femmes enceintes, les enfants, ou si ton système immunitaire est sensible. Privilégier les aliments bio pour les céréales complètes s'avère aussi important puisqu'on mange souvent leur enveloppe externe où s'accumulent davantage de pesticides. Côté produits animaux, les viandes et produits laitiers conventionnels conservent parfois des résidus d'antibiotiques vétérinaires qui sont strictement interdits dans les filières bio. Passer au bio sur ces produits réduit efficacement ce risque potentiel. Ces choix concrets permettent de baisser efficacement et rapidement ton exposition aux pesticides et produits synthétiques potentiellement préoccupants sur le long terme.
Valeur nutritionnelle des aliments biologiques
Les aliments cultivés en bio présentent souvent des différences nutritionnelles plutôt intéressantes. Par exemple, une étude menée par l'Université de Newcastle a montré que les fruits et légumes bio contiennent jusqu'à 60 % d'antioxydants en plus. Ces composés, comme les polyphénols, aident ton corps à lutter contre le stress oxydatif et réduisent certains risques de maladies chroniques.
Autre bonne nouvelle si tu es fan de produits laitiers : le lait bio et la viande issue d'un élevage biologique contiennent généralement plus d'oméga-3. Pourquoi ? Parce que les animaux élevés en bio broutent davantage d'herbes fraîches riches en ces acides gras bénéfiques.
Concernant les minéraux essentiels, les produits bio affichent souvent des niveaux légèrement plus hauts, notamment en magnésium, fer et vitamine C. Même si ces écarts nutritionnels ne changeront pas forcément ta santé du jour au lendemain, consommer bio peut donner un petit coup de boost intéressant à ton alimentation quotidienne.
Attention tout de même à un point : ce n'est pas parce qu'un aliment est bio qu'il est obligatoirement plus sain à tous les coups. Un gâteau bio ultra sucré reste un gâteau ultra sucré, ok ?
Impact environnemental de l'agriculture bio
Influence positive sur la biodiversité
Concrètement, en agriculture bio, tu trouveras en moyenne 30% d'espèces sauvages en plus dans les champs que dans des exploitations conventionnelles. Pourquoi ? Déjà, zéro pesticide chimique : ça permet à tout un tas d'insectes utiles, comme les abeilles sauvages, carabes ou papillons, de s’installer tranquilles. Les infrastructures agroécologiques fréquentes en bio (haies variées, bandes fleuries, mares) attirent oiseaux, hérissons et amphibiens – typiquement les fameux auxiliaires qui régulent efficacement les ravageurs. De nombreuses études, notamment européennes, montrent que les oiseaux communs des plaines agricoles (alouettes, moineaux, bruants…) sont bien plus présents quand l’agriculture bio domine une zone. Petite astuce à reproduire dans ton jardin ou ta ferme : intégrer des cultures diversifiées, laisser des bandes fleuries sauvages ou planter des haies mixtes d’essences locales favorise nettement la biodiversité ordinaire.
Protection des sols et prévention de l'érosion
Les agriculteurs bio limitent l'érosion en bossant sur une couverture végétale permanente des sols : pas question de laisser une terre nue entre deux cultures. Par exemple, les couverts végétaux comme la moutarde blanche, la phacélie ou le trèfle incarnat protègent efficacement la terre contre le vent et les pluies fortes, tout en nourrissant naturellement le sol. L'idée, c'est de favoriser un maximum de racines dans le sol, car ce réseau souterrain retient naturellement la terre et freine son lessivage vers les rivières. Autre méthode intéressante, le travail du sol en surface uniquement (le fameux "travail réduit" ou "non-labour") est souvent adopté en agriculture biologique. Ça préserve la structure naturelle du sol, améliore la vie microbienne et limite sérieusement les pertes de matière organique et l'érosion. Concrètement, une étude de l'Instituto Superior Técnico au Portugal a montré jusqu'à 60 % de réduction d'érosion du sol grâce aux pratiques bio associant couverture végétale et travail minimal comparé au labour conventionnel. Résultat, le sol est plus solide, fertile, et résistant aux intempéries.
Gestion durable des ressources en eau
L'agriculture bio utilise moins d'eau que la conventionnelle. En moyenne, ça fait autour de 30 % de consommation d'eau en moins grâce aux pratiques spécifiques : couverture permanente du sol avec du mulch ou des cultures intermédiaires (prairie temporaire, trèfle...), ce qui limite l'évaporation et protège le sol. De plus, les méthodes d'irrigation typiques en bio, comme la micro-irrigation, sont plus ciblées et efficaces puisqu'elles distribuent l'eau directement au pied des cultures, en fonction du besoin précis (c'est fréquent en maraîchage bio).
Certaines fermes poussent la démarche encore plus loin avec la récupération des eaux de pluie en cuves pour alimenter leur irrigation. Une exploitation maraîchère bio en Bretagne, par exemple la ferme du Bec Hellouin, capte les eaux pluviales pour arroser ses cultures. Ça permet non seulement de préserver les rivières locales, mais en plus, ça soulage la facture en été ! Autre astuce intéressante : planter des haies bocagères ou arbres fruitiers en agroforesterie, une stratégie répandue en bio. Ces arbres et haies régulent naturellement la ressource en eau en retenant l'humidité et limitent le besoin d'arrosage.
Dernier truc très concret : dans le sud de la France, certaines exploitations bio misent carrément sur des variétés de plantes rustiques et résistantes à la sécheresse – typiquement du thym, du romarin ou des variétés anciennes de tomates. Ça consomme beaucoup moins d'eau et ça tourne bien en conditions sèches. Pratique quand on sait que les épisodes de sécheresse risquent de se multiplier.
Coûts et rendements en agriculture biologique
Rendements agricoles du bio comparés à la conventionnelle
En moyenne, la culture bio affiche des rendements environ 20 à 25 % inférieurs à la production conventionnelle. Ça dépend des cultures, mais pour certaines céréales comme le blé, cette différence grimpe même jusqu'à 30 %. Raison principale ? Le bio évite l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques puissants qui boostent massivement les récoltes. Par contre, certaines cultures s'en sortent presque aussi bien en bio qu'en classique, par exemple les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots), grâce à leur capacité naturelle à fixer l'azote présent dans l'air. Autre truc sympa à savoir : même si la production brute est moindre, sur le long terme, les sols cultivés en bio restent plus fertiles, donc ils conservent de bons rendements sans avoir à augmenter continuellement les intrants. Résultat, dans certains contextes où le climat est compliqué (sécheresse, fortes pluies...), les parcelles en bio s'en sortent parfois mieux que les conventionnelles, qui elles, sont beaucoup plus vulnérables à la dégradation des sols et aux aléas climatiques.
Coûts de production et prix des aliments biologiques
Produire bio coûte souvent plus cher à cause du besoin en main-d'œuvre accentué par les pratiques comme le désherbage manuel ou mécanique, là où les conventionnels passent un coup de pulvérisateur chimique et c'est réglé. Résultat, les coûts de main-d’œuvre représentent parfois jusqu’à 30 à 50 % des coûts de production dans certaines exploitations bio, contre à peine 15 à 20 % pour les conventionnelles. À noter aussi les frais liés aux certifications bio obligatoires : un contrôle annuel peut coûter facilement entre 300 et 800 euros, selon la taille de l'exploitation.
Au niveau des prix pour nous, consommateurs, c'est généralement autour de 20 à 30 % plus cher sur les rayons, voire davantage pour certains produits spécifiques comme les fruits rouges ou certaines viandes. Un exemple concret : la pomme bio coûte en moyenne 3,80 €/kg, là où en conventionnel on plafonne autour de 2,40 €/kg. Idem pour le lait bio à environ 1,25 € le litre contre 0,95 € en conventionnel. Si tu veux consommer bio sans exploser ton budget alimentaire, l'astuce c'est de viser les produits locaux et de saison. Acheter directement auprès des producteurs locaux, genre AMAP ou marché fermier, permet souvent de réduire la facture finale tout en soutenant directement les producteurs près de chez toi.
| Agriculture Bio | Agriculture Conventionnelle | |
|---|---|---|
| Utilisation de pesticides | Utilisation limitée de pesticides d'origine naturelle | Utilisation de pesticides chimiques synthétiques |
| Impact sur la santé | Moins d'exposition aux résidus de pesticides | Exposition potentielle aux résidus de pesticides |
| Impact sur l'environnement | Préservation des sols et de la biodiversité | Dégradation des sols et impact sur la biodiversité |
| Coûts et rendements | Coûts de production généralement plus élevés / Rendements parfois plus faibles | Coûts de production généralement plus bas / Rendements parfois plus élevés |
L'agriculture conventionnelle
Utilisation intensive de pesticides et engrais chimiques
Impacts sanitaires potentiels des substances chimiques utilisées
Les pesticides comme le glyphosate, régulièrement utilisé dans l'agriculture conventionnelle, sont soupçonnés d'être liés à certains cancers, notamment le lymphome non hodgkinien d'après le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer). De même, des produits comme les insecticides organophosphorés sont associés à des troubles neurologiques chroniques, y compris chez les agriculteurs exposés régulièrement. Chez les enfants, des études indiquent que l'exposition répétée à certains résidus chimiques présents dans l'alimentation pourrait augmenter les risques de troubles du développement cognitif et hormonal : hyperactivité, baisse du QI ou même puberté précoce. Concrètement, consommer des aliments issus de cultures intensives traitées chimiquement augmente le risque d'ingérer régulièrement certains perturbateurs endocriniens, tels que le célèbre chlorpyriphos, désormais interdit dans l'Union Européenne mais encore toléré dans d'autres régions du monde. Pour réduire au maximum cette exposition aux produits chimiques, mieux vaut favoriser les aliments biologiques, ou a minima bien laver les fruits et légumes conventionnels sous l'eau froide et privilégier leur épluchage quand c'est possible.
Conséquences écologiques connues
Les engrais chimiques azotés, quand ils sont utilisés à outrance, favorisent l'apparition des zones mortes en milieu aquatique. L'azote et le phosphore issus des champs conventionnels finissent souvent dans les rivières et océans. Résultat : prolifération d'algues puis leur décomposition massive qui épuise l'oxygène, entraînant la mort des poissons locaux. Exemple concret : le Golfe du Mexique où chaque année une immense zone privée d'oxygène (environ 15 000 km² en moyenne) se forme à cause des rejets agricoles venus du Mississippi.
Côté biodiversité, l'emploi intensif des pesticides comme les néonicotinoïdes a été clairement lié à l'effondrement des populations d'abeilles et autres pollinisateurs. Certaines études parlent même de baisses spectaculaires, jusqu'à 75 % en Allemagne sur le nombre total d'insectes volants depuis les années 1990. Résultat direct : cultures moins bien pollinisées, donc potentiellement moins productives à terme.
Les sols prennent cher aussi. Les monocultures intensives, accompagnées d'engrais chimiques et produits phytosanitaires, détruisent l'équilibre biologique du sol en éliminant vers de terre, mycorhizes et microbes bénéfiques. Le sol devient progressivement moins fertile, d'où une dépendance accrue aux engrais pour maintenir la productivité.
Enfin, l'agriculture conventionnelle booste l'émission de certains gaz à effet de serre (protoxyde d'azote issu des engrais azotés notamment) contribuant de manière importante au réchauffement climatique. Des études montrent qu'environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont directement ou indirectement liées à l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse.
Effets sur la santé humaine
Exposition prolongée et risques chroniques
Être en contact régulier avec les pesticides chimiques que l'on trouve dans les exploitations agricoles conventionnelles peut entraîner des soucis de santé chroniques assez sérieux. Par exemple, l'agriculteur exposé sur le long terme à des substances comme le glyphosate, classé comme "cancérogène probable" par l'Organisation Mondiale de la Santé, peut avoir un risque augmenté de problèmes de santé graves comme certains cancers, des troubles neurologiques ou encore des déséquilibres hormonaux. Un autre exemple concret : les agriculteurs qui pulvérisent fréquemment des insecticides contenant des composés organophosphorés ont plus de risques de développer des maladies neurologiques comme Parkinson ou des troubles cognitifs précoces. Pour limiter ces risques, il faudrait concrètement encourager les exploitants à porter systématiquement des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés (gants, masques spéciaux), respecter scrupuleusement les délais entre les traitements et la récolte, bien ventiler les espaces traités avant de reprendre les activités à proximité, mais aussi former régulièrement les agriculteurs aux bonnes pratiques et aux dangers spécifiques liés aux produits utilisés.
Risque accru de contamination alimentaire
Quand on utilise des pratiques agricoles conventionnelles, le risque de contamination alimentaire peut clairement grimper. Les résidus chimiques comme les pesticides ou les engrais azotés se retrouvent souvent dans nos aliments, surtout les fruits et légumes où on mange directement la peau (pommes, raisins ou salades par exemple). D'ailleurs, selon une étude de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), jusqu'à 44 % des aliments conventionnels analysés en Europe présentent des traces détectables de pesticides, dont parfois plusieurs différentes substances simultanément.
Ce qu'on oublie souvent, c'est que la contamination alimentaire concerne aussi la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Exemple parlant : dans l'élevage intensif des poulets ou porcs, l'usage fréquent d'antibiotiques destinés à prévenir les maladies favorise l'apparition de superbactéries résistantes, comme certaines souches d'E. coli ou de Salmonella. Ces bactéries résistantes peuvent contaminer la viande consommée, augmentant les risques pour la santé humaine, et rendant le traitement médical plus compliqué en cas d'infection alimentaire.
En pratique, laver les fruits et légumes conventionnels à l'eau claire ne suffit souvent pas à éliminer complètement ces résidus chimiques, même si ça peut un peu aider. Pour diminuer concrètement le risque, privilégier les produits biologiques certifiés, peler les produits non bio quand c'est possible, ou encore opter pour une cuisson plus poussée de certaines viandes non bio afin de limiter l'exposition aux bactéries dangereuses.
Impacts environnementaux liés aux pratiques conventionnelles
Pollution des sols, nappes phréatiques et cours d'eau
L'utilisation intensive de pesticides, herbicides et engrais chimiques dans l'agriculture conventionnelle est la principale responsable de la contamination des sols et des eaux souterraines. Par exemple, l'atrazine, herbicide largement utilisé pour éliminer les mauvaises herbes dans les champs de maïs, a été détectée dans plus de la moitié des points de prélèvement d'eau souterraine en France. Pareil, les nitrates issus d'engrais azotés, utilisés en masse pour booster les rendements agricoles, s'infiltrent dans le sol et se retrouvent dans les nappes phréatiques : résultat, environ 40 % des cours d'eau français sont concernés par des dépassements de seuils acceptables pour ces nitrates. Le problème ? Ces nitrates rendent l'eau du robinet potentiellement nocive, surtout pour les nourrissons. Si tu veux passer à l'action, favoriser des pratiques agricoles moins intensives, comme l'utilisation raisonnée des intrants ou des alternatives biologiques, est une solution concrète pour limiter les dégâts.
Pertes de biodiversité en milieu agricole
Quand on mise à fond sur les rendements à coups de produits chimiques et de monocultures intensives, on dit bye-bye à une tonne d'espèces animales et végétales utiles. Prends l'exemple concret des insectes pollinisateurs : depuis les années 1990, près de 75% de la biomasse d'insectes volants aurait disparu en Europe de l'Ouest, en grande partie à cause des cultures intensives dopées aux pesticides. Pas juste des abeilles — ça concerne aussi papillons, bourdons ou syrphes, tous indispensables à la pollinisation et donc à la production alimentaire.
Les oiseaux aussi font méchamment les frais de ces pratiques. En France, depuis les années 1990, on estime que les populations d'oiseaux agricoles ont diminué d'environ 30%. Quand les paysages deviennent monotones et simplifiés, beaucoup d'espèces ne trouvent plus d'habitats ou de nourriture pour survivre.
Du côté des sols, même combat. La répétition des mêmes cultures avec fertilisation chimique tue progressivement les micro-organismes utiles du sol. On parle ici des champignons, des bactéries et des vers de terre. Un sol pauvre en biodiversité, c'est un sol avec moins de capacité à se régénérer, moins fertile sur le long terme et nécessitant toujours plus de produits chimiques.
Une astuce ultra-actionnable que de plus en plus d'agriculteurs conventionnels commencent heureusement à tester, c'est le retour aux haies bocagères et aux bandes fleuries en bord de champ. Ça favorise le retour des insectes auxiliaires, réduit naturellement les ravageurs et permet aux oiseaux de retrouver le gîte et le couvert. Bref, des petits gestes concrets qui peuvent clairement inverser la tendance et remettre un peu de vie dans les champs.
Foire aux questions (FAQ)
Oui, l'agriculture biologique favorise des pratiques qui préservent la biodiversité, protègent les sols contre l'érosion et limitent les pollutions chimiques. Ces bénéfices environnementaux contribuent à un écosystème plus durable en comparaison à certaines pratiques agricoles conventionnelles.
Non, pas totalement, car certains pesticides naturels sont autorisés en agriculture biologique, bien que leur toxicité soit généralement moindre. De plus, des contaminations accidentelles provenant des cultures conventionnelles voisines peuvent aussi se produire.
L'agriculture biologique génère souvent des coûts plus élevés en raison d'une main-d'œuvre plus importante, de rendements parfois plus bas et de réglementations strictes. Tous ces facteurs influencent directement le prix de vente final pour le consommateur.
Oui, dans la mesure où ils limitent l'exposition aux pesticides et autres substances chimiques potentiellement nocives. Cependant, si certains aliments bio ont montré une légère supériorité en vitamines et minéraux, l'intérêt principal réside surtout dans la réduction des résidus chimiques sur les aliments et leurs effets à long terme sur la santé.
C'est l'objet d'un débat actuel entre scientifiques et experts. Certaines études montrent que l'agriculture biologique, si elle est intégrée à d'autres méthodes durables et innovantes, peut contribuer fortement à nourrir la population mondiale, mais cela nécessite des changements significatifs dans les habitudes alimentaires, notamment une réduction de la consommation de viande et une limitation du gaspillage alimentaire.
Pas nécessairement, car certaines exploitations agricoles conventionnelles adoptent désormais des pratiques respectueuses de l'environnement, comme la réduction des intrants chimiques ou des techniques de conservation des sols et de l'eau. Cependant, l'impact global de l'agriculture conventionnelle reste très souvent plus lourd que celui de l'agriculture biologique.
Pour garantir la certification biologique d'un produit, recherchez les labels officiels, comme le label AB en France ou le logo bio européen. Ces labels garantissent le respect strict d'un cahier des charges précis et reconnu légalement.
Privilégiez essentiellement les fruits et légumes qui retiennent le plus de résidus chimiques lorsqu'ils sont cultivés de manière conventionnelle comme par exemple les fraises, pommes, épinards ou raisins. Vous pouvez aussi privilégier en bio les produits animaux tels que les œufs, le lait ou la viande, pour limiter l'exposition aux antibiotiques et hormones utilisés dans certains élevages conventionnels.
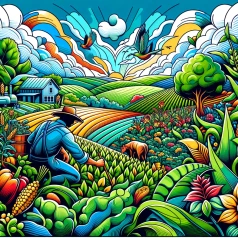
80%
Quantité d'internautes ayant eu 5/5 à ce Quizz !
Quizz
Question 1/5
