Introduction
Se déplacer à pied en ville c'est souvent un parcours du combattant, presque une corvée. Pourtant, une ville bien pensée pour la marche, ça change la vie : ça réduit la pollution, ça relance les commerces du coin, c’est bon pour la santé et ça renforce même les liens entre voisins. Alors comment faire pour rendre nos rues plus accueillantes et piéton-friendly ? Dans cet article, on va décortiquer les principes essentiels de la 'marchabilité' urbaine, regarder comment ça marche ailleurs dans le monde, et explorer des idées innovantes qui pourraient transformer nos villes. Au programme : des trottoirs et chemins pratiques, des rues sûres, confortables et accessibles à tous, une vraie vie de quartier avec des commerces de proximité et des espaces publics sympas. On ira aussi voir comment la technologie et l'expérimentation urbaine peuvent nous donner un petit coup de pouce pour changer nos habitudes. Prêt à repenser la ville un pas après l'autre ? C'est parti !82%
Pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre provenant des zones urbaines
5,2 km
Distance moyenne parcourue à pied par jour par un habitant de Copenhague, une ville réputée pour sa marchabilité
14 minutes
Temps moyen que la population américaine passe à marcher par jour
67.5 milliards de dollars
Coût annuel estimé, en dollars, des décès liés à la sédentarité
Introduction à la marchabilité urbaine
Définition de la marchabilité
Quand on parle de marchabilité, on évoque la facilité qu'offre un environnement urbain à se déplacer à pied confortablement, en toute sécurité et efficacité. Concrètement, c'est un indicateur concret qui prend en compte la qualité des trottoirs, la sécurité aux passages piétons, la proximité des commerces et services essentiels, et même simplement la présence d'arbres pour de l'ombre pendant la marche.
Pour mesurer ça précisément, on regarde différentes choses comme la largeur et l'état des trottoirs (minimum 1,50 mètre conseillé par le CEREMA en France), la vitesse autorisée des véhicules à côté (idéalement 30 km/h maximum en zones piétonnes partagées), ou encore combien de bancs et de points de repos on trouve tous les 200 mètres environ. Autre indicateur pratique : il faut généralement atteindre les commerces du quotidien en moins de 10 minutes à pied pour juger un quartier réellement marchable.
La marchabilité c'est pas juste l'idée sympa qu'on puisse marcher partout, c'est aussi avoir envie de le faire spontanément, sans réfléchir, parce que tous les éléments urbains facilitent la marche, plutôt que de pousser vers la voiture. Bref, plus tu te dis "tiens, finalement je prends pas ma voiture parce que tout est accessible facilement à pied et c'est agréable", plus ton quartier est probablement au top côté marchabilité.
Historique des concepts urbains liés à la marchabilité
C’est autour des années 1960-1970 qu’on commence vraiment à parler de marchabilité dans l'aménagement urbain. Au début, des urbanistes américains comme Jane Jacobs lancent une critique assez cinglante des villes centrées sur la voiture. Jacobs encourage alors des quartiers à taille humaine avec de petites rues, des trottoirs fréquentés et des commerces de proximité, en réaction à l'expansion massive des suburbs américains des années 50.
Vers les années 1980, des initiatives concrètes voient le jour comme le mouvement New Urbanism né aux États-Unis, porté par des architectes comme Andrés Duany et Elizabeth Plater-Zyberk, qui prônent un retour à des villes compactes et accessibles aux piétons. Un bon exemple, c’est la ville de Seaside en Floride, construite entièrement sur ces principes à partir de 1981.
En parallèle, l'Europe du Nord avance beaucoup sur la question, notamment avec la ville de Copenhague. Dès les années 1960, elle ferme certaines rues aux voitures comme la célèbre Strøget, l'une des premières rues piétonnes européennes, initiée en 1962. Cette tendance se diffuse ensuite ailleurs en Europe, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède, avec des expériences concrètes pour le retour massif des piétons et cyclistes en cœur de ville.
Dans les années 1990-2000, le concept continue à se renforcer avec des outils de quantification précis, tels que l'index du « Walk Score » créé en 2007 aux États-Unis. Cet indicateur mesure en chiffres la facilité à vivre sans voiture dans un quartier, ce qui aide les urbanistes à évaluer clairement les points forts et faibles de chaque zone.
Dernièrement, on constate que des grandes métropoles mondiales, de Paris à Séoul en passant par New York, appliquent ces principes à grande échelle, en transformant autoroutes urbaines et parkings en espaces piétons voire jardins urbains. Du coup, l'idée de villes « marchables » n’est plus seulement un truc sympa sur papier, elle est devenue une priorité concrète dans le développement urbain mondial.
Bénéfices de la marchabilité
Bénéfices environnementaux
Développer la marchabilité urbaine réduit directement les émissions polluantes dues aux voitures. En limitant l'utilisation de véhicules motorisés, tu peux diminuer efficacement la pollution de l'air : des villes comme Oslo ont enregistré des baisses significatives de particules fines après avoir étendu leur réseau piétonnier en centre-ville. Marcher davantage aide même à lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbains, car remplacer l'asphalte par du revêtement léger, végétal ou perméable permet de faire baisser de plusieurs degrés la température dans les villes. Concrètement, planter des arbres le long des rues piétonnes peut rafraîchir l'air ambiant jusqu’à 5 degrés en période chaude, selon des mesures réalisées à Barcelone. Aussi, en ajustant la ville aux marcheurs plutôt qu'aux voitures, tu permets aux sols de mieux absorber l'eau de pluie, ce qui réduit le ruissellement et diminue le risque d'inondations en cas d'épisodes pluvieux intenses. Enfin, moins de voitures, c’est souvent moins de bruit ambiant : les piétonisations mises en place à Gand en Belgique ont fait chuter les nuisances sonores de près de 8 décibels, ce qui change clairement la qualité de vie en ville.
Bénéfices économiques locaux
Rendre une ville plus piétonne, ça paye. Plusieurs études montrent que quand les rues deviennent agréables à parcourir à pied, l'activité commerciale locale grimpe en moyenne de 30 %. Par exemple, à New York, après avoir rendu Times Square piéton, les ventes dans les commerces avoisinants ont augmenté de 22 %, avec plus de gens qui s'arrêtent pour acheter et consommer directement sur place.
Avoir plus de piétons, ça veut dire aussi plus de clients potentiels devant les vitrines. Les commerces en zones piétonnes réalisent en général jusqu’à 40 % du chiffre d'affaires hebdomadaire de plus par mètre carré que ceux situés dans des rues classiques. Moins connu : les magasins implantés dans des rues attractives pour les piétons constatent non seulement une hausse des ventes immédiates mais aussi une fidélisation plus forte des clients locaux, surtout ceux situés à moins de dix minutes de marche.
Autre donnée intéressante : l’aménagement d'une rue en faveur des piétons coûte bien moins cher qu'un projet centré sur la voiture. À Londres, par exemple, réaménager une rue commerçante en rue piétonne apporte jusqu'à cinq fois plus de revenus comparé aux mêmes investissements dans des infrastructures routières traditionnelles. Mieux encore, la valeur immobilière dans ces espaces grimpe souvent, car les gens aiment vivre et travailler à proximité d'endroits accessibles et agréables.
Enfin, multiplier les zones marchables développe une économie locale diversifiée. On assiste à l'émergence de cafés indépendants, de boutiques spécialisées et de projets communautaires créateurs d'emplois. À Melbourne, les ruelles auparavant délaissées se sont transformées en lieux dynamiques, boostant de 300 % les demandes de permis commerciaux locaux en quelques années seulement.
Bénéfices pour la santé publique
En gros, une ville qui pousse les gens à marcher, c'est une ville où les habitants tombent moins souvent malades, surtout pour le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par exemple à Copenhague, où environ 41 % des déplacements se font à pied ou à vélo, le taux d'obésité chez les adultes reste stable autour de 10 %, bien en-dessous d'autres grandes villes plus centrées sur la voiture. Une étude à Melbourne a démontré clairement que les quartiers aménagés pour favoriser les déplacements piétons permettent aux résidents d'avoir environ 35 minutes d'activités physiques quotidiennes en plus comparé à ceux qui habitent des quartiers moins marchables. Marcher régulièrement améliore aussi la santé mentale : diminution de près de 30 % des symptômes dépressifs selon certaines recherches. D'ailleurs, des travaux récents montrent que les villes favorisant une bonne marchabilité observent souvent des niveaux de stress globalement plus faibles chez leurs habitants. Plus on marche au quotidien, plus on retarde l'apparition de problèmes liés au vieillissement, comme les pertes osseuses ou musculaires. C'est pas qu'une question individuelle non plus : à grande échelle, mieux vaut investir dans la marchabilité que de gérer les conséquences économiques des maladies chroniques. Par exemple, selon une estimation de l'OMS, chaque euro investi dans un plan favorisant la mobilité active permettrait d'économiser jusqu'à environ 3 euros en dépenses de santé publique à long terme.
Bénéfices sociaux et communautaires
Quand une ville est vraiment piétonne, la vie de quartier reprend clairement le dessus. À Pontevedra, en Espagne, la piétonnisation du centre-ville a permis aux liens de voisinage de se renforcer. Des espaces publics mieux conçus font bondir de près de 50 % les interactions sociales spontanées locales, selon une étude du projet international Gehl sur l’espace urbain.
Autre effet concret : les commerces locaux retrouvent une seconde jeunesse. À Bristol, au Royaume-Uni, après que le centre-ville a été rendu majoritairement piéton en 2020, on a observé une augmentation significative des ventes dans les cafés et commerces indépendants du secteur.
Chez les jeunes et les personnes âgées, c’est l'autonomie qui fait un bond. Quand une personne n’est plus obligée de prendre sa voiture pour chaque petite sortie, elle devient très vite plus présente dans la vie de quartier. À Montréal, des quartiers apaisés et marchables comme le Plateau Mont-Royal voient émerger des réseaux de solidarité locale spontanée : aide aux courses, accompagnement des seniors, organisation spontanée de petits événements conviviaux entre voisins.
Et puis, parlons inclusion : une étude américaine menée à Portland montre qu’un milieu urbain pensé pour être parcouru à pied favorise la rencontre entre groupes très différents. Ça casse la dynamique du "vite rentré chez soi". Résultat, les lieux marchables deviennent naturellement plus mixtes et inclusifs sur le plan culturel et social.
Enfin, moins intuitif, mais vrai : des quartiers plus marchables voient baisser leurs taux de criminalité légère. Une étude de l'université de Virginie occidentale (West Virginia University) pointe en effet une réduction d’environ 10 % des délits mineurs dans les quartiers bien aménagés pour les piétons. Normal : quand les rues sont plus fréquentées et vivantes, ça dissuade automatiquement certains comportements problématiques. Le sentiment de sécurité s'installe naturellement, sans avoir à multiplier les caméras ou les policiers en patrouille.
| Avantage | Description | Impact | Exemple |
|---|---|---|---|
| Amélioration de la santé publique | Réduction de la sédentarité et des maladies cardiovasculaires | Réduction des coûts de santé et amélioration de la qualité de vie | Mise en place de zones piétonnes et de pistes cyclables à Copenhague, Danemark |
| Préservation de l'environnement | Réduction des émissions de CO2 et de la pollution atmosphérique | Amélioration de la qualité de l'air et lutte contre le changement climatique | Réseaux de transport en commun efficaces à Zurich, Suisse |
| Dynamisation de l'économie locale | Augmentation de l'attractivité des commerces de proximité | Création d'emplois et augmentation des recettes fiscales | Aménagement d'espaces conviviaux à Bogota, Colombie |
Principaux critères de conception urbaine favorisant la marchabilité
Connectivité et continuité des itinéraires
Aménagement des trottoirs et chemins piétons
La largeur idéale d'un trottoir pour faciliter le passage confortable de deux personnes côte à côte ou d'un fauteuil roulant est d'environ 1,80 mètre. Pour une expérience plus cool, notamment dans les rues commerçantes ou fréquentées, viser plutôt autour de 2,50 mètres minimum, comme à Copenhague où c'est devenu une référence.
Pensez aux matériaux : privilégiez des revêtements antidérapants, perméables et faciles à entretenir (type béton désactivé ou dalles drainantes) plutôt que des pavés glissants sous la pluie, histoire d'éviter des cascades improvisées par les piétons.
Un truc souvent oublié mais super utile : prévoir une légère pente (2 à 3 %) pour évacuer correctement l'eau de pluie vers la chaussée. Ça évite les flaques immenses qui trempent les jambes au passage des voitures.
Côté pratique, intégrer des bandes podotactiles bien placées pour faciliter les déplacements des malvoyants, avec des couleurs contrastantes pour renforcer la visibilité.
Enfin, planter des arbres ou prévoir du mobilier urbain régulièrement (bancs, poubelles discrètes, abris pluie légers), environ tous les 50 à 100 mètres, permet de ponctuer agréablement le parcours et de rendre la balade plus sympa. C'est ce qu'ont fait par exemple Barcelone avec ses "superilles" et Melbourne dans certaines rues commerciales, avec des résultats très positifs sur l'affluence piétonne.
Éviter les ruptures dans le parcours piétonnier
Une erreur classique côté urbanisme, c'est d'oublier les petits détails qui créent des ruptures dans une balade piétonne. Exemple flagrant : des trottoirs interrompus par une rue ultra fréquentée sans passage sécurisé ou bien des voies piétonnes coupées brutalement par un parking ou un chantier sans itinéraire alternatif clair. La clé, c'est d'assurer des connexions simples et fluides pour traverser rues, carrefours ou zones en travaux. Par exemple, Barcelone s'est illustrée avec ses fameuses "Superblocks" : des îlots urbains réorganisés pour donner la priorité aux piétons et aux cyclistes, limitant drastiquement les interruptions. Action rapide à mettre en place : identifier les endroits où les piétons rebroussent chemin ou préfèrent contourner un obstacle en passant sur la chaussée, puis installer des passages surélevés, des aménagements provisoires clairs ou des traversées piétonnes bien signalées et sécurisées. Concrètement, surveiller régulièrement les trajets naturels empruntés grâce à des outils numériques comme le crowdsourcing piéton (type appli Strava Metro), ça permet de repérer les ruptures moins évidentes, mais gênantes au quotidien. Prendre le temps de "marcher la ville" soi-même ou avec des habitants du quartier est aussi ultra efficace : c'est sur le terrain que tu comprends vraiment ce qui bloque.
Sécurité et confort des usagers
Eclairage public adapté
Un bon éclairage public, ce n'est pas seulement avoir de la lumière partout, mais plutôt le bon type de lumière aux bons endroits et au bon moment. Certaines villes, comme Copenhague ou Lyon, ont installé des lampadaires intelligents équipés de détecteurs de présence. Résultat, la lumière augmente seulement lorsque quelqu'un passe, ce qui permet d'éviter la pollution lumineuse inutile et de réduire la consommation d'énergie parfois jusqu'à 50 %.
Autre point important : choisir la bonne température de lumière. Une lumière trop blanche (froide) abîme non seulement les yeux mais perturbe aussi le sommeil des riverains et la faune nocturne. Privilégier des lumières chaudes (autour de 2700 à 3000 Kelvin maximum) améliore le confort visuel et rassure les piétons.
Enfin, l'éclairage doit être pensé à hauteur de piétons et pas seulement à hauteur de voiture. Plutôt que de grands poteaux élevés espacés tous les 50 mètres, des luminaires plus bas (3 à 4 mètres maximum), et positionnés à intervalles réguliers rapprochés créent un cheminement visuel plus agréable. Vienne (Autriche), par exemple, a repensé son éclairage de quartier avec des lampadaires plus bas orientés directement sur le trottoir, réduisant ainsi les zones d'ombres et améliorant le sentiment de sécurité.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Penser l'accessibilité, c'est avant tout concevoir une ville sympa et équitable pour tous. Pour les personnes à mobilité réduite, ça veut dire aménager des rues vraiment praticables, sans marches inutiles ni trottoirs trop étroits. Installer des bandes podotactiles aux intersections et devant les passages piétons aide énormément les malvoyants à se repérer. D'ailleurs, la ville de Barcelone en a fait une norme partout dans son réseau piétonnier, et ça marche plutôt bien.
Autre truc concret : prévoir des rampes d'accès avec des pentes inférieures à 5 %, ainsi que des espaces de repos tous les 30 mètres environ pour les trajets en montée. Un exemple intéressant : à Stockholm, les planificateurs urbains testent des trottoirs équipés de chauffage antigel, pour éviter aux fauteuils roulants les mauvaises surprises en hiver.
Enfin, prévoir une vraie signalétique claire, lisible, parlant aussi bien à ceux en fauteuil qu'aux personnes âgées ou déficientes visuelles, et installer des bancs avec des accoudoirs pratiques pour s'appuyer. Ces petits détails cumulés font toute la différence entre une ville où l'on galère et une ville vraiment accueillante.
Espaces publics de détente et de repos
Créer des espaces publics de détente, ça ne veut pas juste dire poser quelques bancs et c'est réglé. Concrètement, ça passe par des aménagements qui facilitent l'interaction, comme installer des mobilier urbain modulable, par exemple des sièges ou bancs mobiles que les gens peuvent adapter selon leurs besoins, comme à Times Square à New York où on peut déplacer certains sièges comme ça nous arrange.
Ça implique aussi d'installer des éléments végétalisés spécifiques qui améliorent vraiment le confort des piétons : choisir par exemple des platanes ou des érables pour apporter un ombrage efficace et rafraîchir naturellement l'air ambiant en période chaude, au lieu de simplement mettre quelques arbustes de décoration. À Séville en Espagne, ils l'ont parfaitement compris avec notamment l'aménagement végétalisé des avenues principales pour créer des couloirs ombragés contre la chaleur.
Pour faciliter l'interaction sociale, il vaut mieux créer des petits espaces de repos regroupés plutôt que disperser des bancs individuels. On le voit bien à Copenhague ou Amsterdam, où les villes misent sur des mini-points d'arrêt regroupant bancs, végétation et même parfois des petites tables, pour encourager les gens à se poser ensemble et favoriser les liens entre habitants.
Dernier truc utile : prévoir chaque fois qu'on peut des solutions simples contre les intempéries, comme des abris légers ou des auvents discrets mais bien placés. Newcastle au Royaume-Uni, par exemple, développe pas mal ce genre d'aménagements légers super efficaces pour permettre une utilisation confortable toute l'année.
Densité et mixité fonctionnelle
Promotion des commerces de proximité
Pour booster la marchabilité, il est important d'avoir des commerces à taille humaine, proches des habitations et faciles d'accès à pied. Une action efficace : prévoir des exemptions ou réductions de taxes locales pour l'installation des petits commerçants en ville. Par exemple, Paris a mis en place le programme Vital'Quartier depuis 2004 : pendant plusieurs années, la ville a racheté des locaux vides pour les louer à loyer modéré à des boulangeries, épiceries fines, librairies indépendantes. Résultat : plus de 370 commerces réinstallés dans les coins où les boutiques classiques avaient disparu.
Autre levier concret : favoriser des zones commerciales à loyers progressifs, où les commerçants paient peu au démarrage, histoire de leur donner le temps de s'établir sans pression. À Lille, la municipalité a ainsi offert des loyers réduits les 3 premières années dans certains quartiers pour encourager les commerces locaux.
Important aussi, prévoir directement dans les règlements d'urbanisme des clauses précises (zonage commercial spécifique) qui empêchent que les rez-de-chaussée soient transformés systématiquement en bureaux, agences immobilières ou appartements privés. À Bordeaux, la mairie impose ainsi un pourcentage minimal de locaux commerciaux actifs dans certains secteurs résidentiels.
Enfin, plusieurs villes (comme Strasbourg) ont créé des labels genre "Boutique à l'essai" qui offrent aux nouveaux entrepreneurs un local à prix réduit (voire gratuit) pendant quelques mois, histoire de tester leur concept avant de se lancer pleinement.
Bref, moins de galères administratives et financières permettent à terme de retrouver facilement les essentiels du quotidien à moins de 10 minutes à pied, réduisant ainsi l'utilisation inutile de la voiture.
Aménagement d'espaces multifonctionnels
Prévoir des espaces multifonctionnels, c'est penser à des endroits où les habitants peuvent à la fois se détendre, flâner, se rencontrer, et accéder facilement à des services utiles. Concrètement on peut installer des places centrales modulables, qui changent de fonction selon la période de l'année : marchés locaux en semaine, petit cinéma plein air le week-end ou simplement zone de repos au quotidien. Exemple parlant : la Plaça dels Àngels dans le quartier du Raval à Barcelone, où skateurs, passants, touristes et marchés coexistent sans problème. Côté mobilier urbain, privilégier des bancs et tables facilement amovibles ou pliables permet une adaptation rapide aux événements ponctuels et ne bloque pas les usages quotidiens de l’espace. Penser multifonctionnel, c’est aussi imaginer des toits ou terrasses pouvant simultanément accueillir des jardins urbains partagés (végétalisation pour le bien-être et la biodiversité) et des petits coins conviviaux pour des rencontres ou des mini-événements. Tout est affaire d’anticipation et d’empathie envers les usages réels des habitants, plutôt que de miser uniquement sur le côté esthétique ou conceptuel de l’aménagement.

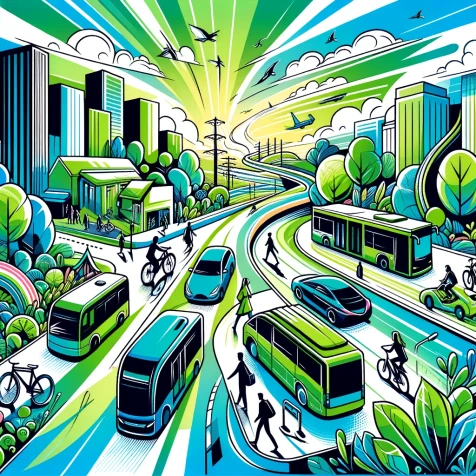
20 %
Réduction des risques de décès prématurés pour les personnes actives physiquement
Dates clés
-
1898
Création de la notion de 'Cité-jardin' par Ebenezer Howard, intégrant les premiers principes de piétonisation et d'accessibilité à pied.
-
1961
Publication de 'The Death and Life of Great American Cities' par Jane Jacobs, réhabilitant l'importance de la vie piétonne dans les espaces urbains.
-
1970
Première expérimentation majeure de piétonisation en Europe avec la fermeture du centre-ville de Copenhague au trafic automobile, initiant le célèbre projet Strøget.
-
1987
Rapport Brundtland, marquant la mise en avant à grande échelle du concept de développement durable, incluant la réflexion sur une ville plus humaine et marchable.
-
2000
Lancement de la Charte européenne du piéton par le Parlement européen, renforçant la reconnaissance institutionnelle de la marchabilité dans les politiques urbaines.
-
2005
Création du label 'Walk Friendly Communities' par plusieurs organismes américains, définissant des critères précis pour évaluer la marchabilité des villes.
-
2009
Création du réseau international 'Walk21', fédérant des chercheurs, planificateurs, élus, pour soutenir et encourager la mise en œuvre de politiques favorables à la marche en ville.
-
2015
Adoption de l'Agenda 2030 par les Nations Unies avec ses Objectifs de Développement Durable (ODD), intégrant des recommandations explicites permettant de promouvoir la marchabilité.
Exemples internationaux de mise en place réussie de la marchabilité
Exemples en Europe
Aux Pays-Bas, la ville d'Almere a opté pour le concept du quartier sans voiture. Le quartier Oosterwold a réduit drastiquement les rues destinées aux véhicules : seulement 20 % de la surface est dédiée aux déplacements automobiles. Le reste ? Du piétonnier, des pistes cyclables et des espaces naturels. Les habitants sont totalement libres d'imaginer leurs propres maisons, mais doivent respecter l'idée de ne pas envahir l'espace urbain avec des voitures.
À Pontevedra, petite ville du nord-ouest de l'Espagne, on a choisi la radicalité. Depuis 1999, les responsables locaux ont fermé la majeure partie du centre-ville aux véhicules motorisés. Résultat : une baisse de 70 % des émissions de CO₂ dans le périmètre concerné et zéro accident mortel depuis la mise en place du dispositif.
Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, a misé dès les années 2000 sur le quartier Vauban. Ce quartier à logements éco-conçus mise sur le piéton et le vélo : voitures garées hors de la zone habitée avec interdiction totale de transit automobile. 70 % des déplacements se font désormais à pied ou à vélo dans ce secteur.
Oslo aussi a frappé fort : depuis 2019, le trafic auto a été quasiment éradiqué du centre en supprimant la plupart des places de parking sur voirie et en multipliant trottoirs larges, zones piétonnes, et terrasses de cafés. Résultat direct : aucune victime piétonne ou cycliste en 2019, contre cinq décès dans la même zone en 2014.
À Gand, en Belgique, en divisant le centre-ville en six secteurs distincts, la municipalité a réduit de façon spectaculaire la circulation automobile de transit. Cela a stimulé la marche : en centre-ville, la part des déplacements piétons est passée de 14 % à près de 21 % en deux ans seulement.
Enfin, Copenhague et Amsterdam continuent d'être des références incontournables. À Copenhague, par exemple, le piéton est privilégié grâce à un réseau dense de voies piétonnes, qui atteignent aujourd'hui près de 80 000 m², stimulant fortement l'économie locale. Amsterdam mise quant à elle sur une combinaison intelligente entre la marche à pied et le vélo, avec des espaces ultra sécurisés et clairement délimités pour chaque mode de déplacement. Résultat : des habitants satisfaits et un dynamisme économique avéré des rues commerçantes.
Exemples en Amérique du Nord
À Portland, dans l’Oregon, les quartiers comme Pearl District ou Alberta Arts District sont réputés pour leur environnement urbain pensé pour le piéton. Par exemple, à Pearl District, la municipalité a supprimé certaines voies dédiées à la voiture pour les transformer en promenades piétonnes, avec petits cafés et galeries directement accessibles à pied.
À Montréal, la métropole québécoise se distingue avec ses axes piétonniers saisonniers. La Rue Sainte-Catherine devient entièrement piétonne chaque été depuis plusieurs années, stimulant ainsi les commerces locaux. Montréal a d’ailleurs vu une hausse d’environ 30 % dans les revenus des boutiques établies le long de ces axes durant la période piétonnisée, d’après les données publiées par la Ville en 2020.
À Vancouver, le programme Greenways connecte quartiers résidentiels, commerces de proximité, espaces verts et stations de transport en commun par un réseau de voies piétonnes et cyclables sûres. Entre 2012 et 2019, Vancouver aurait réussi à créer plus de 140 km de ces chemins piétonniers sécurisés et accessibles à tous.
New York aussi s’illustre depuis une dizaine d’années avec la reconquête de ses espaces publics. La transformation radicale de Times Square en 2009, qui a converti la moitié de l’espace réservé aux véhicules en zone piétonne, est un exemple célèbre. Résultat : une réduction de 40 % des accidents piétonniers dans ce secteur selon les données officielles du Department of Transportation de New York. La fréquentation touristique et les achats dans les commerces ont également augmenté, validant ainsi la démarche piétonne de la ville.
Autre cas intéressant, la petite ville américaine de Carmel, dans l’Indiana. Elle est devenue célèbre ces dernières années en adoptant une stratégie complète pour favoriser la marche plutôt que la voiture. Carmel a remplacé quasiment tous ses feux rouges par des ronds-points — près de 135 au total en 2022 — permettant de réduire les accidents de près de 80 % comparé aux intersections traditionnelles, tout en facilitant les déplacements piétons par des trottoirs élargis et sécurisés.
Exemples en Asie et Océanie
À Singapour, les quartiers comme Marina Bay ou Orchard Road sont pensés dès le départ pour être ultra piétons. Résultat : proximité des commerces, arbres partout pour l'ombre, trottoirs larges et même passages couverts pour rester au sec quand il pleut (et à l'abri du soleil écrasant). Ils utilisent aussi une appli officielle, MyTransport.SG, qui donne des trajets piétons pratiques et actualisés, intégrés avec bus et métros.
À Melbourne (Australie), la ville a fait du super boulot avec ses "laneways" (petites rues étroites et animées). Cafés branchés, fresques murales colorées, terrasses et concerts en plein air, tout pour donner envie aux gens de venir flâner à pied. Résultat : la marche représente aujourd'hui environ 40 % des trajets au centre-ville !
À Séoul, le projet Cheonggyecheon est top : ils ont arraché une autoroute urbaine en plein cœur de la ville pour faire un espace piétonnier paysagé le long d'une rivière restaurée de presque 6 kilomètres. La fréquentation explose depuis : près de 90 000 visiteurs quotidiens, majoritairement à pied.
Christchurch (Nouvelle-Zélande), après le séisme de 2011, n'a pas reconstruit sa ville comme avant. Ils ont opté pour des aménagements piétons innovants avec le programme Share an Idea. Résultat : rues piétonnes avec sièges publics et bornes wifi gratuites, plein d'endroits pour se poser entre amis ou pour bosser à l'air libre.
Enfin, Tokyo mise beaucoup sur ses chemins piétonniers couverts, comme dans le quartier de Ginza, avec ses passages souterrains pratiques et ses trottoirs surdimensionnés. Parce que oui, être piéton à Tokyo, avec ses millions d’habitants, c'est super agréable et facile. Le quartier de Shibuya, par exemple, accueille chaque jour plus de 2 millions de piétons, notamment sur son fameux carrefour connu mondialement pour son dynamisme urbain.
Le saviez-vous ?
Le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne, conçu en privilégiant la marchabilité et les déplacements doux, affiche une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par habitant en comparaison avec le reste de la ville.
Une enquête à Copenhague dévoile que les rues piétonnes attirent en moyenne 30% de clients supplémentaires dans les commerces locaux par rapport aux rues où domine la circulation automobile.
Selon une étude menée par l'Organisation Mondiale de la Santé, les adultes devraient pratiquer au minimum 150 minutes de marche à pied modérée chaque semaine pour renforcer leur système cardiovasculaire et prévenir les maladies chroniques.
Saviez-vous que le terme 'walkability' (marchabilité en français) a été popularisé à partir des années 1990 pour mesurer la facilité et la sécurité avec lesquelles les habitants d'une ville peuvent circuler à pied dans leur environnement quotidien?
Stratégies innovantes pour intégrer la marchabilité aux plans urbains
Recours aux nouvelles technologies et outils numériques
Les villes exploitent de plus en plus les nouvelles technologies pour booster leurs plans piétons. Prenons l'exemple des applications mobiles dédiées aux marcheurs : elles cartographient précisément chaque trottoir, chemin ou passage piéton, et indiquent même où il y a trop de bruit, de pollution ou des travaux gênants. Aujourd'hui, certaines villes, comme Barcelone et Amsterdam, utilisent des capteurs IoT directement intégrés aux lampadaires pour obtenir en temps réel des données sur la fréquentation des rues, détecter les zones dangereuses ou mal éclairées, et peaufiner ensuite leurs aménagements urbains. À Singapour, la technologie LIDAR analyse même les déplacements des piétons, permettant de repérer les endroits où le trafic est trop dense ou les trottoirs trop étroits. Côté participatif, des plateformes numériques comme FixMyStreet donnent la possibilité aux habitants de signaler rapidement un trottoir dégradé, un lampadaire hors service ou un obstacle gênant. Ces outils collaboratifs accélèrent considérablement les réparations du mobilier urbain et améliorent directement la vie des usagers. Autre innovation super pratique : la réalité augmentée. À Londres, certaines applications utilisent la RA pour guider les piétons vers des itinéraires agréables, agrégeant au passage des informations sur les commerces ou les sites remarquables à proximité. Mieux : des start-up développent aujourd’hui des algorithmes capables d’analyser les parcours les plus empruntés par les piétons à l'aide d'images satellites et de données mobiles. Grâce à ça, les aménagements urbains peuvent coller encore mieux aux réalités des utilisateurs.
Urbanisme tactique et expérimentation
Quand on parle d'urbanisme tactique, on parle d'action directe et rapide sur la ville. C'est une façon concrète d'améliorer la marchabilité, en testant directement sur le terrain des aménagements provisoires, que les urbains peuvent expérimenter en temps réel avant toute validation définitive.
Par exemple, certaines villes françaises telles que Nantes ou Grenoble ont utilisé des marquages au sol temporaires et du mobilier urbain mobile pour tester la piétonnisation de places et de rues. Dans le cas de Grenoble, ils ont transformé plusieurs quartiers grâce à du street art, des bancs et des jardinières provisoires. En quelques mois, les habitants ont pu tester l'effet d'une ville apaisée et donneuse de place aux piétons.
À New York, l'urbanisme tactique a révolutionné une partie de Times Square en 2009. Ils ont tout simplement fermé une voie à la circulation, installé quelques chaises pliantes, dessiné une peinture temporaire au sol et observé ce qu'il se passait. Résultat : l'endroit est devenu hyper convivial, les piétons se sont approprié l'espace, les commerces et cafés alentours ont augmenté leur chiffre d'affaires, et la ville a validé définitivement la piétonnisation l'année suivante.
L'intérêt principal de cette méthode, c'est son coût hyper maîtrisé et sa souplesse. Plutôt que de dépenser des millions en aménagements permanents dès le départ, on tente, on observe, et on ajuste le tir si besoin. L'autre avantage, c'est la participation citoyenne : les habitants testent eux-mêmes et disent directement ce qu'ils aiment ou pas.
À Montréal, une opération baptisée "Piano public" a installé des pianos droit sur des trottoirs et cauchemars routiers : ça a transformé les rues concernées en espaces de rencontre, incitant les gens à ralentir et à profiter du quartier différemment. Pas mal pour quelques pianos récupérés et repeints.
Bref, en urbanisme tactique, la démarche est simple : prendre un coin de rue somnolent ou dangereux pour les piétons, le métamorphoser à l'aide d'éléments rapides et bon marché (peinture, mobilier temporaire, végétaux mobiles), et laisser les citoyens se réapproprier progressivement leur espace public. Si ça marche, on pérennise ; sinon, on réajuste sans avoir gaspillé des budgets titanesques.
Foire aux questions (FAQ)
Plusieurs outils existent comme les systèmes d'information géographique (SIG) pour analyser les déplacements piétons, les applications mobiles recueillant les retours et suggestions des citoyens sur le confort piétonnier, ou encore des capteurs connectés permettant d'étudier les flux et comportements des piétons dans la ville.
Parmi les meilleures pratiques figurent l'élargissement et la rénovation des trottoirs, l'amélioration de l'éclairage public, la sécurisation des traversées piétonnes, l’aménagement d’espaces verts ou de repos, et l'encouragement d'une mixité fonctionnelle incluant des services de proximité accessibles à pied.
Plusieurs critères permettent d’évaluer la marchabilité : présence de trottoirs larges et en bon état, sécurité routière, proximité des commerces et services essentiels, continuité des itinéraires piétons, aménagement d’espaces publics agréables ainsi que niveau d'accessibilité pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite.
Promouvoir la marchabilité améliore la qualité de vie urbaine en réduisant les embouteillages et la pollution, favorise une meilleure santé publique grâce à l'encouragement de l'activité physique régulière, stimule l'économie locale, renforce le lien social, et limite l'utilisation des énergies fossiles.
La marchabilité désigne la facilité, la sécurité et l'attractivité avec lesquelles les piétons peuvent se déplacer dans les rues d'un environnement urbain. Elle inclut des aspects tels que la connectivité, l'accessibilité, la sécurité, le confort et la convivialité des espaces publics.
Oui, certaines villes sont reconnues internationalement pour leur excellente marchabilité : Copenhague, Amsterdam ou Barcelone en Europe, mais aussi San Francisco ou Vancouver en Amérique du Nord, ou bien encore Melbourne en Océanie. Ces villes ont mis en place des stratégies ambitieuses favorisant systématiquement les piétons dans leur organisation urbaine.
Oui, plusieurs études montrent que les quartiers dotés d'une haute marchabilité voient généralement leurs biens immobiliers prendre une valeur supérieure, car ces quartiers offrent un cadre de vie confortable, attractif et répondent mieux aux attentes actuelles en matière de mobilité durable et de proximité.
Les principaux obstacles sont souvent liés à l’aménagement urbain ancien favorisant trop fortement la voiture particulière, le manque d’investissement public dans l'infrastructure piétonne, le faible engagement des acteurs locaux, ainsi qu'une faible prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite dans la conception urbaine.

Personne n'a encore répondu à ce quizz, soyez le premier ! :-)
Quizz
Question 1/5
